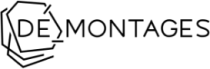Compte rendu de : Sophie JEHEL et Alexandra SAEMMER (dirs.), Éducation critique aux médias et à l’information en contexte numérique, Villeurbanne, Presses de l’Enssib, coll. « Papiers », 2020.
Si le titre du volume peut résonner comme une formule institutionnalisée « Éducation critique aux médias et à l’information en contexte numérique », le parcours que je voudrais néanmoins emprunter pour réfléchir avec cet ouvrage collectif est justement celui qui cherche à s’interroger sur l’intention programmatique d’une « éducation critique aux médias et à l’information ». L’insertion de l’adjectif critique dans la désignation de la discipline peut avant tout s’entendre comme le corollaire de l’actualisation de celle-ci au contact des nouveaux dispositifs numériques, ces derniers étant depuis 2013 au cœur de prescriptions pédagogiques émanant des politiques publiques sans que ne soit réellement pensée une approche critique à leur endroit (p. 9-101). La question qui est alors posée est celle de la liberté et de l’autonomie des utilisateurs vis-à-vis des contraintes imposées par les objets techniques. L’heureuse volonté du livre est à cet égard de ne pas réduire le projet éducatif à « une incantation de l’esprit critique », mais de l’enjoindre à « [tenir] compte des difficultés à prendre du recul sur des contenus et des dispositifs, du fait à la fois de leur performativité, de leur potentiel de fascination, des services qu’ils rendent et de la grande opacité de leur fonctionnement » (p. 11). Les directrices de l’ouvrage soulignent ainsi l’importance d’élaborer des perspectives méthodologiques afin de s’écarter des écueils des kits pédagogiques, fiches pratiques et grilles de lecture « clés en main », souvent requis auprès des actrices et acteurs de l’éducation aux médias2.
Sans aborder de front la question des effets spécifiques de la donnée numérique sur l’éducation aux médias3, il s’agirait donc de tenter de saisir, en partie, comment se pense ici la discipline au travers des dispositifs, contenus et pratiques qu’elle prend pour objet, des questionnements qu’elle promeut, des attitudes qui la sous-tendent ou encore des visées qui fondent son ambition éducative.
Objets et pratiques médiatiques
Parce qu’il influencera tant les questions posées que les démarches avancées, le plan du rapport à l’objet étudié différencie passablement les dix-huit contributions de l’ouvrage entre elles. On dégagera à gros traits des lignes de convergence, constitutives des fonctions alors attribuées à l’éducation aux médias. De manière générale, la nécessité d’étudier les contenus médiatiques numériques est pointée comme résultant de la combinaison de deux facteurs corrélés, à savoir le pouvoir de formatage des comportements et des représentations que détiennent ces objets ainsi que la place ou le rôle social qu’ils ont acquis (cf., par exemple, le ch. 10).
1. Le propos articule ainsi presque systématiquement, d’une part, une mise en lumière des médiations contraignantes des systèmes technologiques et des impensés qu’ils véhiculent4 avec, d’autre part, un examen des modalités de résistance qui peuvent s’y jouer. Les analyses se penchent de ce fait sur ladite « culture participative5 » – Sébastien Broca réfléchit au pouvoir de subversion du mouvement du logiciel libre et à ses limites, Clément Mabi aux « effets démocratiques » des civic tech (technologies de participation citoyenne) –, sur les logiciels de création – le livre numérique sert d’exemple à Nicole Pignier, qui y voit une performance « contre-figurative » (Goffman), et occupe surtout Nolwenn Tréhondart, qui se penche sur le conditionnement opéré en amont par le logiciel du « livre numérique enrichi » et ses discours d’accompagnement –, ou encore sur les pratiques d’écritures créatives, notamment au sein de Facebook, qu’Alexandra Saemmer décrit comme une praxis littéraire à même d’engager une démarche réflexive, voire de gêner certains systèmes d’exploitation de la plateforme.
L’éducation critique est alors régulièrement celle qui pousse à investir l’interstice, la marge de manœuvre. L’usage fréquent de la notion d’affordance6 en est un bon révélateur: e.g., les informaticiens du logiciel libre tablent sur la hackability des technologies investies (ch. 4), le discours d’escorte des dispositifs de participation citoyenne construit, d’après les observations de C. Mabi, un « récit démocratique », lequel repose sur quatre types d’affordances s’établissant dans la relation entre utilisateurs et outils numériques (affordances de légitimité citoyenne, de qualité délibérative, d’empowerment, de collaboration critique).
C’est dans un sens similaire que sont mobilisées les idées d’écart, de contre-figuration, ou de créativité – sur laquelle nous reviendrons. Je note simplement encore que c’est par la métaphore de la « brèche » que Fardin Mortazavi parle des potentialités critiques de son projet théâtral dans l’entretien qui clôt le volume : le geste d’observation critique est pratiqué par le comédien dans l’expérience d’une brèche qui surgit dans l’espace-temps, une ouverture à de nouvelles significations potentiellement permise par une intensification du vécu esthétique et offrant au comédien une prise à son appropriation du monde, en dehors des ressorts de la pensée hégémonique (ch. 18).
2. On observe ensuite un intérêt notable pour ce que l’on perçoit communément comme les dangers liés tant à l’usage des dispositifs qu’aux stratégies des industries numériques : les cyberviolences dont le cybersexisme (ch. 2), la défiance vis-à-vis de l’information journalistique dès lors que celle-là est assimilée à la désinformation, au complotisme, à la radicalisation (ch. 8), les stratégies occultes des plateformes (ch. 7), leur travail de conditionnement affectif (ch. 6).
La récurrence parmi les contributions de ces dangers liés à des comportements déviants n’est pas loin d’inférer que l’éducation aux médias aurait principalement un rôle à jouer en tant qu’outil de lutte contre ce que l’on qualifierait schématiquement de « mauvaises pratiques médiatiques ». Cet outil serait alors nécessaire à l’entretien d’un rapport avec les médias que l’on voudrait responsable (Guillaume Sire parle de « sensibiliser à la fois à la responsabilité du moteur [dont le fonctionnement n’est pas neutre et demande à être déconstruit] et à la responsabilité de l’utilisateur » [p. 98]) ou plus apaisé (Sophie Jehel, qui se concentre sur les processus de défiance chez les adolescents, suggère des réponses éducatives pouvant « aider à dépasser des postures de colère ou de provocation » [p. 125]7).
Cependant, l’ouvrage ne peut être confiné au régime de la dénonciation et il n’est pas non plus question pour moi d’écarter l’importance de ces enjeux. Je ne pense en effet pas qu’il faille perdre de vue ce qui est ressenti comme un enjeu parental, démocratique ou social et qui fait donc l’objet d’une forte demande éducative. Il me semble en revanche que l’on gagne à rester attentif aux rapports que ces enjeux construisent avec les objets « auxquels on éduque » et à la manière dont ces approches courent le risque, parce qu’elles sont socialement légitimées ou qu’elles travaillent leur légitimation, de mener malgré elles à une forme de paralysie critique, freinant les possibilités de remise en question des appuis symboliques sur lesquels elles se fondent. Ces présupposés éducatifs (c’est-à-dire les dangers dont il faut se prémunir) ont un pouvoir légitimant indéniable et peuvent par là même masquer une série d’enjeux moins évidents8. On pourra en ce sens retenir la proposition formulée ici par A. Cordier qui invite à réfléchir à la discipline en
promouvant une vision ambitieuse de l’éducation à l’information et aux médias, affranchie d’un opportunisme contextuel qui peut nier l’épaisseur des savoirs sous-tendus par un tel projet éducatif, le réduisant à une litanie d’injonctions et de préventions (p. 244).
3. Enfin, l’ouvrage renferme également des réflexions qui s’écartent de l’analyse des objets et pratiques médiatiques en eux-mêmes pour proposer un point de vue méta, porté vers des démarches éducatives ou des questions de recherche. Le chapitre 1, en bonne place, introduit à un état des lieux synthétique de l’éducation aux médias dans un contexte dominé par le sujet des fake news : Romain Badouard y souligne la prépondérance et les limites d’une démarche procédurale et recadre une série d’enjeux de base liés à une question qui peine à s’éloigner d’une appréhension moralisatrice. En écho, le chapitre 9 aborde la notion de « lutte » contre les fausses informations et les représentations qu’elle construit implicitement. Ceci conduit Léo Jannot-Sperry à se questionner sur le fact-checking et les pratiques de régulation des plateformes ainsi que sur la mise en forme des contenus pédagogiques d’éducation aux médias. Le chapitre 17 s’arrête quant à lui sur la formation des professeurs documentalistes en réclamant des moyens d’« acquisition d’une culture technique » (p. 127). Cette méta-perspective touche aussi la notion de créativité, dont le chapitre 13 fournit une définition psycho-cognitive qui la relie à la « pensée divergente » et qui se confronte, au chapitre 12, avec la pertinente remise en cause des conditions d’utilisation pédagogique de cette créativité au sein d’un dispositif de formation et d’un cadre institutionnel spécifiques (IDEFI-CréaTIC).
Les chapitres 10 et 16 sont clairement ceux qui réfléchissent le plus directement à problématiser des démarches de recherche. Marlène Coulomb-Gully fait la proposition théorique forte du Genre comme outil englobant, comme méta-méthodologie dont, à la manière du rôle joué précédemment par le structuralisme et le marxisme, les Sciences humaines et sociales pourraient s’approprier les gestes de recherche (au rang desquels la prise en compte de la portée de la parole de l’enquêté sur sa propre pratique et de la valeur heuristique de l’expérience minoritaire ou quotidienne, la remise en cause de la neutralité et de l’objectivité du chercheur). Anne Cordier revient pour sa part sur les cadres d’analyse qui guident sa recherche de terrain, laquelle vise à établir les « biographies informationnelles » de ses jeunes enquêtés. Elle met en lumière une série de facteurs importants pour cette démarche, pointant surtout, avec Ricoeur, la puissance de l’imaginaire comme déterminant de l’action sociale ; ceci pousse notamment à voir les contradictions auxquelles certains mythes discursifs soumettent les acteurs étudiés, pris entre un discours institutionnel, ou la projection des attentes de l’institution, et leurs propres ressentis et pratiques.
Toujours dans cette perspective, mais plus ponctuellement, on soulignera également les textes de Serge Proulx et Alexandra Saemmer. Le premier pose la question de l’illusion du pouvoir retrouvé par la maîtrise du code informatique et note les limites, une fois mis à l’épreuve de la figure de la société de contrôle, du « modèle de l’appropriation » tel qu’il l’avait développé (ch. 3) ; la seconde oppose la pertinence pédagogique revêtue par la critique incarnée qu’est la création littéraire en milieu numérique à la posture de surplomb traditionnellement adoptée dans une sociologie du dévoilement (ch. 14).
Outils critiques et visées éducatives
Les questions qui me guident ici cherchent simplement à mettre davantage à plat des logiques de raisonnement : comment ces textes mobilisent-ils la notion de « critique » ? à quelles attitudes renvoie-t-elle, pour atteindre quel objectif ?
On peut ainsi repérer, bien que la question soit relativement marginale, qu’une forme de subjectivation peut jouer le rôle d’outil critique. Dans l’idée de résister voire de faire déraper le système d’une société de surveillance et de son contrôle par le numérique, S. Proulx fait valoir le rôle que peuvent jouer les « singularités particulières » pour soutenir diversité et dynamisme informationnel (p. 59). M. Coulomb-Gully souligne quant à elle le pouvoir d’interpellation de la subjectivité des expériences vécues et considère que cette dimension personnelle constitue un outil de réflexion dans la démarche scientifique.
Mais l’outil critique le plus vivement mis en avant est bien celui de la compréhension du milieu informationnel et numérique et donc de la déconstruction de ses stratégies éditoriales, ses conditions de production et de réception ; il s’agit entre autres de rendre sensible aux stratégies affectives du web par le biais d’un travail de déconstruction du « digital affective labor » (ch. 6), de conscientiser les médiations du numérique (ch. 11, en particulier, ou ch. 7), lesquelles touchent notamment le sujet des algorithmes ou de la matérialité du support. Ce type de questionnement est également mobilisé à un niveau d’abstraction supérieur lorsqu’il se détache plus ou moins fort des objets médiatiques à proprement parler pour produire un examen des valeurs et des mythes d’un mouvement ou d’une culture (ch. 4, 5), d’un discours (ch. 9, 12, 16), d’une société (ch. 3).
Cette démarche donne lieu à une invitation à la réflexivité des utilisateurs dans leur pratique. Le chapitre 5 propose une démarche réflexive jalonnée par des « points de vigilance » vis-à-vis des technologies participatives (qui produit le dispositif et avec quelle intention ? quelle relation est nouée avec le participant ?) ; la réflexivité sur les usages semble donc surtout devoir à nouveau passer par un décodage du dispositif. Ailleurs, la réflexivité se voit sollicitée de façon privilégiée non plus dans la vigilance mais dans l’incertitude, l’épaisseur, l’ambigüité de la littérature par opposition à l’automaticité de la technique (ch. 14) ou encore dans le travail théâtral en tant qu’il invite à la mise en abyme de ses propres usages (ch. 18). Plus avant, N. Tréhondart parle indirectement de créer les conditions d’une démarche socio-sémiotique réflexive, laquelle serait à construire avec les étudiants par le biais d’exercices d’introspection idéologique permettant de se positionner face aux contraintes qui orientent la réception.
Je reviens au travail de déconstruction mobilisé dans les textes. L’idée sous-jacente à cette démarche (surtout en ce qui concerne le premier type de déconstruction mentionné, c’est-à-dire celui concernant directement les objets médiatiques numériques) est que conscientiser les stratégies des dispositifs permet de mettre à distance leurs effets. Une mise à distance que bloque le régime implicite de ces modalités, dont le propre est d’être cachées, ou de se donner pour techniques, donc neutres. Tout en souscrivant pleinement à la fécondité d’un travail d’analyse de l’implicite et des systèmes idéologiques embarqués dans les dispositifs, l’explicitation de cette logique permet de questionner l’immédiateté systématique qui s’établirait dans le rapport entre une prise de conscience des modalités contraignantes d’un dispositif et la capacité à ne plus y être perméable9. Un aspect de cet enjeu est d’ailleurs formulé en introduction : « Il est une chose de savoir que l’offre d’information des plateformes numériques n’est pas neutre ; il en est une autre de se défaire de la fascination qu’elles exercent » (p. 23). La résolution de cette difficulté – et c’est probablement là la proposition nodale de l’ouvrage – se situerait dans le travail de « l’expérience sensible de l’outil », celui-ci permettant de convoquer les automatismes, explicités puis déjoués.
L’outil critique le plus régulièrement mobilisé10 est par conséquent le détournement des dispositifs, l’écart, la contre-figuration, la créativité. Cette activité critique est directement reliée aux principales ambitions éducatives que l’ouvrage attribue à la discipline. Celles-ci correspondent à ce que Marlène Loicq identifie comme le caractère citoyen que se donne le modèle socioculturel de l’éducation aux médias en contexte républicain français11. Le projet éducatif résonne avec les notions d’autonomisation, de prise de contrôle, d’empowerment et vise à former des citoyens critiques, en capacité d’agir de manière autonome et raisonnée, actifs sur le plan publique et politique.
Je note également que l’ouvrage avance, plus discrètement, deux autres objectifs pour la discipline, plus ou moins autonomes par rapport au point précédent. Le premier est celui de former au débat, et au dissensus. R. Badouard réclame en ce sens des espaces d’échange, en dehors du débat médiatique traditionnel, qui fassent exister des points de vue divergents (voir aussi ch. 3 et 18). Ce paradigme côtoie par ailleurs son pendant consensuel, principalement par le prisme de la notion de collaboration : la participation critique est celle qui collabore en vue de parvenir à des préférences politiques partagées (ch. 5), l’activité créative favorise les échanges collaboratifs (ch. 13) tout comme la « chasse au canular » (ch. 17, p. 262). L’autre objectif assume l’ambition pour la discipline de participer à une transformation de la société. En adéquation avec la perspective numérique qui porte l’ouvrage, S. Broca développe l’idée qu’une telle transformation « implique la transformation consciente [des] technologiques [de cette société] » (p. 68). M. Coulomb-Gully souhaite elle aussi que l’éducation aux médias se dote d’un « impératif citoyen » et, qu’à l’image de l’« engagement éthique » soutenu par les études de Genre, elle projette de transformer les rapports sociaux.
Gestes de recherche
Ce parcours m’a arbitrairement conduite à ramener à la question de l’éducation critique l’inventaire des pratiques, initiatives, projets que ce livre s’applique à documenter. Les différentes recherches menées relayent et amplifient en effet la parole des professeurs, des élèves, des acteurs du numérique et les conceptions que toutes ces personnes en construisent. J’ai été particulièrement intéressée par les tensions et contradictions que ces démarches ont pu mettre au jour. Parmi elles, on pourra renvoyer au conflit déjà évoqué des imaginaires et des attentes institutionnelles (ch. 16)12 ou à l’analyse de S. Broca, qui montre qu’une « éthique hacker du travail13 » – qui s’exprime notamment à travers le principe du copyleft (hack juridique subvertissant la notion de propriété en la rendant inclusive [p. 71]) – ne parvient toutefois pas à atteindre l’absence totale de contraintes hiérarchiques. C. Ferjoux documente également avec précision les situations vécues dans la pratique par les professeurs documentalistes, sources de tensions en raison d’une différenciation trop peu établie entre les aspects technologique et pédagogique de leurs responsabilités (p. 248-253)14. Cette attention accrue aux « logiques contradictoires » qui traversent l’ensemble du paysage médiatique est un projet englobant auquel invite M. Coulomb-Gully (p. 152).
Enfin, le geste de déconstruction déjà mis en évidence ne détient pas la même portée critique en fonction de s’il se consacre aux objets médiatiques ou au regard que l’on y applique. Plusieurs contributions construisent une méta-réflexivité dégageant des pistes pour une démarche critique vis-à-vis de la manière dont est produite le savoir. On y retrouve l’observation d’un cadre social structurant, produisant une interprétation des systèmes (contre-)hégémoniques par une historisation des idéologies (le ch. 3 analyse le passage d’une dite « société de l’information » à une société de surveillance et de contrôle) ou une généalogie des pratiques d’opposition (le ch. 16 retrace les gestes critiques et les paradoxes du parcours accompli par la littérature numérique), ainsi que l’idée que puisse être politisé quelque chose qui de l’est pas au départ (ch. 3 et 4).
*****
En fin de compte, les niveaux auxquels s’exercent la démarche critique tendent à se confondre. Si je me dis qu’il s’agit d’une riche contagion, il me semble aussi que ceci participe à laisser dans le champ de l’impensé le passage entre ces différents plans, ceux de l’analyste, de celui que l’on concevrait comme un citoyen en devenir et d’une éducation, que l’on veut tous trois critiques. Les modalités d’interaction entre ces différents niveaux restent pour moi source d’interrogations (peut-on par exemple considérer que le caractère critique de l’éducation découlerait d’un certain rapport aux modes de constitution des savoirs qui la supporte ? et une éducation, parce qu’elle est critique, forme-t-elle de ce fait à être critique ?). La répétition du mot « sensibiliser » et sa pragmatique floue me renvoient notamment à ce hiatus entre les paliers critiques. Celui-ci peut aussi s’observer en filigrane de l’intitulé de la première partie de l’ouvrage « Éduquer à l’information, décoder les infomédiaires » : la structure appositive d’identification formalise ce hiatus tout en établissant un rapport de corrélation dont le caractère direct resterait à interroger, notamment en ce qu’il anticipe un chemin de réception, celui de l’internaute émancipé des jeux d’influence émanant des dispositifs et de leurs contenus.
La créativité semble être la jonction pédagogique mise en avant par le collectif, qui invite donc à réfléchir à cet outil. À mon sens, ce dernier peut courir le risque de s’appuyer sur une dualité qu’il parait important de déconstruire à son tour, à savoir celle d’une activité créatrice lucide d’un côté, autonome, en capacité d’agir par le simple fait d’être agissante, et, de l’autre, une réception passive, plus encline à être agie par le dispositif et les contenus auxquels elle s’expose. On soulignera à la fois que l’activité critique ou participative est aussi sujette aux effets de cadrage idéologique et contrainte par le contexte, notamment scolaire, qui la commande15 et qu’il est réducteur de concevoir les activités de réception par le prisme de la passivité, en niant par là les processus de négociation du sens et en lui dénigrant la capacité à ne pas subir un environnement symbolique. Ce que dit Jacques Rancière dans les premières pages de Le spectateur émancipé est à ce sujet très éclairant:
Qu’est-ce qui permet de déclarer inactif le spectateur assis à sa place, sinon l’opposition radicale préalablement posée entre l’actif et le passif ? Pourquoi identifier regard et passivité, sinon par la présupposition que regarder veut dire se complaire à l’image et à l’apparence en ignorant la vérité qui est derrière l’image et la réalité à l’extérieur du théâtre ? […] Ces oppositions – regarder/savoir, apparence/réalité, action/passivité – sont tout autre chose que des oppositions logiques entre termes bien définis. Elles définissent proprement un partage du sensible, une distribution a priori des capacités et incapacités attachées à ces positions. […]
L’émancipation, elle, commence quand on remet en question l’opposition entre regarder et agir, quand on comprend que les évidences qui structurent ainsi les rapports du dire, du voir et du faire appartiennent elles-mêmes à la structure de la domination et de la sujétion. Elle commence quand on comprend que regarder est aussi une action qui confirme ou transforme la distribution des positions. Le spectateur aussi agit, comme l’élève ou le savant. Il observe, il sélectionne, il compare, il interprète16.
Pris dans son ensemble (et notamment selon son organisation en deux parties), l’ouvrage pourrait laisser entendre qu’il place la créativité comme une étape supplémentaire, qui vient enrichir et intensifier l’activité réflexive. Malgré l’importance donnée ici à cette activité réflexive, l’attention se porte en général davantage vers les injonctions véhiculées par les outils numériques et leurs stratégies éditoriales sans nécessairement envisager ouvertement la complexité de l’activité réceptive. Je rebondis toutefois à nouveau sur le texte de N. Tréhondart (mais c’est aussi ce qu’invitent à faire les ch. 4 ou 5 au sujet du hacking ou des civic tech), dans lequel on peut lire en creux qu’il est nécessaire de réfléchir aux impensés du dispositif de formation17 et, surtout, de créer les conditions pour que la démarche créative fonctionne sur le plan critique : le texte s’arrête sur les situations de rencontre-débat avec des professionnels, qui souvent se révèlent improductives en matière de distanciation critique dans la mesure où elles n’offrent pas les conditions pour mettre à distance l’adhésion aux discours des concepteurs de logiciels créatifs. De la même manière, le propos soulève que les processus d’évaluation tendent à détourner la créativité vers la production de simples « prototypes esthétisants » (p. 180). Une démarche peine à être en elle-même critique si elle ne réfléchit pas à ses présupposés ainsi qu’aux conditions de sa mise en œuvre. Ces questions entrent en résonance avec le propos de Melina Solari Landa, qui, avec David Buckingham, met au centre de sa réflexion les tensions d’un contexte :
Les acteurs de l’École sont encore une fois à la croisée des chemins dans un contexte où, d’un côté, le marché essaie de rendre actifs les jeunes comme consommateurs et producteurs des médias afin de les rendre « émancipés » des adultes, et de l’autre, par l’inflexibilité de la forme scolaire, l’École essaie de « maintenir » la passivité des élèves18.
Il ne s’agit aucunement de rejeter les qualités heuristiques d’une activité productrice, sa capacité à faire réfléchir à une forme et à ses effets sur un récepteur. Toutefois, le danger est, je crois, de reconduire la dualité évoquée en mobilisant la création ou la production comme geste pédagogique émancipateur par essence. Dans le cas où la création est mobilisée comme un modèle qui comporterait en lui-même les conditions d’un succès éducatif, celle-ci court le risque de se figer dans les traits d’une solution pérenne toute trouvée, éloignée des situations particulières qui devraient la mettre à l’épreuve. Elle s’exposerait finalement par là à réintégrer la logique du « kit pédagogique » et ses promesses d’efficacité d’apprentissage.
(1) Les renvois aux pages dans le corps du texte réfèrent à l’ouvrage recensé, tout comme les numéros de chapitre (généralement privilégiés ici aux noms de leurs auteurs dans une volonté de lire l’ouvrage davantage dans son ensemble).
(2) Voir à ce propos la réponse humoristique (en « recettes ») des « anti-boîtes à outils » proposées par le Petit manuel d’éducation critique aux médias (collectif La Friche, Éditions du commun, 2021 ; https://www.editionsducommun.org/products/petit-manuel-deducation-critique-aux-medias).
(3) Pour réfléchir à cet enjeu épistémologique, on peut notamment se reporter à Marlène Loicq, « De quoi l’éducation aux médias numériques est-elle la critique ? », tic&société [En ligne], Vol. 11, N° 1, 2017, consulté le 17 mai 2021. URL : http://journals.openedition.org/ticetsociete/2286 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ticetsociete.2286.
(4) Plusieurs contributions font en ce sens référence à la notion foucaldienne de « dispositif ».
(5) Henry Jenkins, Mizuko Ito, danah boyd, Culture participative. Une conversation sur la jeunesse, l’éducation et l’action dans un monde connecté, Caen, C & F éditions, coll. « Les enfants du numérique », 2017.
(6) Celle-ci renvoie aux possibilités d’action, objectives ou perçues (les premières, dans la pratique, tendent à se calquer sur les secondes), qu’offrent un environnement à un agent. Voir dans l’ouvrage les pages 66-69 et 77-85.
(7) La piste éducative que suggère à cette fin la chercheuse dans la conclusion du chapitre est celle d’une « explicitation des modalités de la production de l’information, des contraintes juridiques et économiques » (p. 125). Il me semble que cette corrélation pédagogique s’écarte de la compréhension stimulante des mécanismes de construction du sens mise en place dans la deuxième partie de l’article, au sujet des entretiens qualitatifs et de l’enquête de terrain auprès d’adolescents (de 15 à 18 ans) dans différents établissements scolaires. On voit en effet mal comment une colère dont l’origine, pour paraphraser le propos, se situe dans un sentiment de maltraitance de la part des médias vis-à-vis des quartiers populaire, sentiment augmenté par l’interdépendance entre le médiatique et le politique, puisse (ou doive ?) être dépassée par la compréhension des modalités de production de cette information perçue comme blessante.
(8) Ces questions sont toutefois plus habilement discutées grâce à l’articulation, menée dans l’article « Chercheurs et acteurs de l’EMI : tous dans le même bateau ? », des propos de Laurent Petit, Melina Solari Landa, Nathalie Walczak et Mathieu Bégin (Communication & langages, 2019/3, n° 201, pp. 89 à 109). Autour d’une réflexion sur les rapports entre recherche et éducation aux médias, les auteurs soulèvent notamment les points suivants : le dépassement, dans la formation des formateurs, des besoins exprimés, la prise de conscience d’enjeux sous-jacents au dispositif de formation, l’intégration de luttes sociales dans les savoirs normés.
(9) Voir à ce propos la manière dont Jeremy Hamers complexifie ce rapport par la problématisation critique du « paradigme émancipatoire » et en invitant à repenser les modalités de réception des productions médiatiques : « Le faux documentaire et l’éducation aux médias. Sous-genre et critique d’un paradigme émancipatoire ».
(10) Bien que la créativité soit avancée comme outil pédagogique critique de façon récurrente, c’est surtout le chapitre 14 qui fournit une véritable analyse de contenu d’une pratique créative au sein du numérique.
(11) Loicq, art. cit., p. 150.
(12) Sur l’enjeu de la gestion par les élèves des contradictions et tensions entre l’école traditionnelle et l’intégration du numérique, voir le propos de Melina Solari Landa dans Laurent Petit, Melina Solari Landa, Nathalie Walczak et Mathieu Bégin, art. cit.
(13) L’auteur emprunte le concept à Pekka Himanen ; voir p. 72.
(14) Je souligne le lien possible qui s’établit entre ces tensions du milieu éducatif et un « déplacement du discours pédagogique vers les entreprises privées », lien qu’étudie Nathalie Walczak (Laurent Petit, Melina Solari Landa, Nathalie Walczak et Mathieu Bégin, art. cit., p. 99).
(15) Voir à ce propos Barbara Laborde, De l’enseignement du cinéma à l’éducation aux médias. Trajets théoriques et perspectives pédagogiques, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2017, p. 120.
(16) Jacques Rancière, Le Spectateur émancipé, Paris, La Fabrique, 2008, p. 19.
(17) Celle-ci met en évidence le langage managérial du dispositif de formation, où l’exigence de « rendement créatif » s’alimente d’une attente de résultats et de pression concurrentielle (p. 179).
(18) Laurent Petit, Melina Solari Landa, Nathalie Walczak et Mathieu Bégin, art. cit., p. 95.