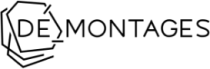Compte-rendu de Roy Pinker, Fake news et viralité avant internet. Les lapins du Père-Lachaise et autres légendes médiatiques, Paris, CNRS ÉDITIONS, 2020, p. 231.
Texte publié par la revue CoNTEXTES. Référence : Elise Schürgers, “Raconter l’historique du copier-coller”, COnTEXTES [Online], Notes de lecture, Online since 14 March 2022. URL: http://journals.openedition.org/contextes/10665; DOI: https://doi.org/10.4000/contextes.10665
L’apparition de la formule fake news dans le débat public francophone, principalement à la faveur des élections américaines de 2016, signe la répétition d’une observation attentive, avant tout, aux nouveautés de notre culture médiatique. En janvier 2017, aux premiers pas du lexème fake news dans la presse française, Le Monde glose par exemple l’anglicisme avec la sobriété de l’évidence : « “fake news” (diffusion de fausses informations sur Internet)1 ». Dès ses débuts francophones, le phénomène est en effet d’emblée caractérisé comme étant ajusté tant à un espace – les plateformes numériques – qu’à un mode d’existence médiatiques – ce dernier étant celui de la circulation, de la propagation, de la prolifération. On publie moins une fake news qu’on ne la diffuse. Par ailleurs, si des discours porteurs de relativisations historiques émergent rapidement (le faux, la manipulation, la rumeur ont toujours existé), la récurrence de motifs tels que « à l’ère des fake news » ou « dans un monde de fake news » est un indice du cadrage au travers duquel le discours social donne à penser le phénomène, en l’occurrence celui d’un problème propre à nos sociétés contemporaines et à leur tournant numérique.
Vis-à-vis de ces questions, l’ouvrage de Roy Pinker (pseudonyme2 dont jouent trois auteurs, Pierre-Carl Langlais, Julien Schuh et Marie-Ève Thérenty) signale une orientation dès son titre : Fake news et viralité avant Internet. Les chapitres centraux, 15 études de cas autonomes, fonctionneront ensuite selon une logique d’illustration itérative de cette affirmation liminaire : la viralité, fondée sur un phénomène de reprise de contenu, est un mécanisme ancien, « consubstantiel à toute société médiatique » (p. 14). Dans la littérature scientifique, on trouve des travaux adoptant les deux types d’approche : l’une mettant l’accent sur les phénomènes de la rumeur, des fake news, de la désinformation ou encore des théories du complot au travers de la spécificité du medium numérique3 et l’autre s’attachant à l’historicisation de ces objets et de leurs mécanismes de diffusion4. Ce qui singularise à nos yeux l’ouvrage de Roy Pinker dans le traitement de ces objets pourrait se répartir aux travers de trois gestes imbriqués, constitutifs de la démarche adoptée : tout d’abord, l’attention portée aux interactions entre le vrai, le faux et le fictif (une perspective qui n’est pas sans rappeler le travail de Carlo Ginzburg dans Le fil et les traces), la construction systématique, ensuite, de parallèles historiques entre des contenus et des figures médiatiques contemporains et leurs potentiels anciens avatars et enfin, une écriture que l’on peut qualifier de didactique.
Rendre compte des intersections entre vrai, faux et fiction dans la presse donne aux auteurs la possibilité de brasser une large gamme de phénomènes dont la nature et la part de faux fluctuent : nouvelles parodiques, fausses citations, publicités déguisées ou fictionnalisées, horoscope, caricatures, légendes urbaines, portraitomanie (correspondant à de multiples façon de donner accès à des éléments biographiques de célébrités) sont autant de productions pour lesquelles ce caractère faux se bigarre de rapports au détournement, à l’humour, au profit, à la fiction.
En ce sens, l’ouvrage se dédie moins à une conceptualisation du « faux médiatique » qu’à une théorisation et illustration de la viralité5. La première fait effectivement l’objet du chapitre conclusif : en repartant des positions de Gabriel Tarde6 soulignant le pouvoir de structuration sociale des formes de diffusion horizontale (dans une logique interindividuelle de micro-imitations), le chapitre décrit la viralité comme un type de communication reposant sur des mécanismes d’imitation, de rediffusion, de réappropriation, de remédiation (opposés ici à la création7) et caractérisé par une diffusion décentralisée, collective et anonyme ainsi qu’une réduction de l’opposition entre producteur et récepteur. L’objet viral est quant à lui identifiable par son caractère synthétique ou simplifié ainsi que son potentiel émotionnel et de décontextualisation, « résultat d’adaptation aux contraintes de diffusion des divers écosystèmes médiatiques où se produit la communication » (p. 201).
L’illustration de ce mécanisme viral permet l’analyse de phénomènes aussi divers que la globalisation culturelle – le chapitre XIII compare les fictions à grand succès mondial sur Netflix à la « mysterymania » locale et internationale autour des Mystères de Paris (dont la diffusion en feuilleton faisait, d’après Théophile Gautier, que « des malades attendaient pour mourir la fin des Mystères ») –, la robotisation des rubriques de l’horoscope – le chapitre XI fournit une véritable généalogie de la médiatisation des prédictions astrologiques et de leur automatisation, les mêmes qui ont intéressé le sociologue Edgard Morin en 19828 (voir p. 149-151) –, le plagiat convenu qui préside à la circulation des blagues et histoires drôles (ch. V), ou encore le puff, charlatanisme d’une publicité à outrance qui a l’habileté de « faire du bruit pour rien », voire de faire travailler les consommateurs eux-mêmes (ch. VIII).
Si les 15 études de cas ne cessent par ailleurs de démontrer l’intense contagion entre objets médiatiques et fictionnels ou littéraires9, y voir « du vrai » est un travail qui se construit en filigrane du propos. Il faut en effet insister ici sur le fait que, par ses analyses, Roy Pinker montre également par endroits que ces avatars du faux peuvent aussi dire le vrai, au sens où ils nous renseignent de façon précieuse sur les conditions matérielles de l’existence des contenus médiatiques, sur les aspirations, les peurs, et les valeurs d’une société donnée10 ou sur la façon dont ses acteurs font communauté11. Si l’on veut bien y être attentif, ce qui se met en place est, pour reprendre les mots de Ginzburg, une « stratégie de lecture » vigilante aux traces laissées par ces objets ; ceux-ci sont alors lisibles « à rebrousse-poil »12, c’est-à-dire contre l’intention des auteurs ou, dans ce cas-ci, à rebours de leur simple mise au banc en raison de leur nature mensongère, légère, intéressée ou simplement virale (cf. p. 12). Pour n’en prendre qu’un seul exemple, l’étude consacrée aux fausses citations (intitulée « “Ne croyez pas à toutes les citations que vous lisez sur internet” (Abraham Lincoln) ») s’amorce avec les citations motivantes issues du domaine du développement personnel pour s’arrêter sur cette fausse citation attribuée à un général lors de la déroute de Waterloo : « La garde meurt mais ne se rend pas ». S’il est évident que la formule est inventée pour satisfaire un besoin de bravoure dans la défaite, elle témoigne aussi d’une maîtrise des codes de diffusion d’une parole formulée pour pouvoir être reprise13 et du poids de l’élaboration collective. Ce chapitre dit aussi le contexte de cette controverse qui émerge en réalité au moment de généralisation du système de régulation qu’est la note de bas de page, « nouvelle morale citationnelle » (p. 84) transformant une pratique courante en erreur grave.
La figure comparative centrale de l’ouvrage, à savoir celle qui relie le copier-coller du clavier numérique à une écriture journalistique dite « à la colle et aux ciseaux », préside à tous les autres parallèles tissés entre des contenus ou pratiques médiatiques contemporaines et leurs échos historiques (e.g., la cyberattaque et le « hacking » du télégraphe optique, le Gorafi et le mystificateur Lemice-Terrieux, les albums Panini et les portraits de célébrités à collectionner pour fidéliser la clientèle, la rumeur du vol d’enfants dans les supermarchés circulant sur les réseaux sociaux et la légende urbaine de la Vénus à la tête de mort). Si ces comparaisons, plutôt que de faire l’objet d’une analyse spécifique, remplissent davantage la fonction d’accroche à l’entame de chacun des chapitres, l’effet critique qui émerge de la démarche sur le plan général est bien sûr d’abord celui de mieux comprendre ce que peuvent être les caractéristiques à la fois structurantes et permanentes dans une culture médiatique (le motif du dévoilement a posteriori de la vérité, que l’on associerait à la pratique moderne du fact-checking, est l’un de ces mécanismes persistants). Ensuite, il nous semble que ceci permet également, en creux, une réflexion sur les formes matérielles que prennent les contenus médiatiques et les supports qui en font la médiation. C’est par exemple le cas pour la caricature du visage de Louis Phillipe en poire dont le dessin « saute d’un journal à un mur, d’un mur à une affiche, d’une affiche à un cahier d’écolier, d’un cahier d’écolier à une illustration dans un roman », la multiplication des supports (comme la multiplication des lieux où on entendra une chanson ou ceux où l’on verra le détournement d’une image en mème) participant à la création d’un effet hégémonique : « il devient impossible de voir une poire sans penser à la caricature » (p. 38-39).
On soulignera encore à ce sujet la grande richesse du matériau textuel et iconographique abondamment cité et montré14 ainsi que le « post-scriptum », consacré à la numérisation de larges corpus de presse ancienne et aux pratiques de recherche qui les exploitent. En refermant l’ouvrage par un précieux propos méthodologique et réflexif, ces pages reviennent avec nuance sur les biais et opportunités de ces bases de données et de leur exploitation automatisée (si les logiciels de reconnaissance optique imposent certaines transformations aux textes, ces bibliothèques numériques ont l’avantage de suspendre les hiérarchisations qui président habituellement aux choix des corpus) tout comme elles rappellent que l’apport principal est celui d’une extrapolation – par le quantitatif – sur le long terme de tendances que l’on juge pertinentes pour l’étude de l’histoire culturelle.
Nous terminons ici par un mot sur ce qu’on pourrait presque qualifier de choix stylistique posé par ce livre, lequel n’est pas étranger à une forme de vulgarisation. Au-delà du lexique très accessible – qui à la fois apporte une aide à la lecture, répond à la volonté de Roy Pinker de ne pas tomber dans la paranoïa du « tout fake news » et tend à dénaturaliser les étiquettes de cette catégorie de productions médiatiques –, c’est finalement le mouvement de narration, et surtout le plaisir qui en résulte, que nous voudrions faire valoir. Ce plaisir que l’on prend à la lecture, déjà souligné ailleurs15, n’est certes probablement pas étranger au talent d’écriture de ces micro-récits qui, avec un certain sens du suspens, retracent le parcours d’une rumeur ou d’une mystification, ainsi que les évènements d’histoire socio-culturelle qui jalonnent cette trajectoire (nous y avons par exemple appris en souriant que le « deuxième livre imprimé par Gutenberg, alors que sa Bible n’est pas encore sortie des presses, est une collection de tables astrologiques » [p. 139] ou que la loi créant le monopole de l’État sur les télécommunications publiques avait été votée deux semaines après le procès ayant acquitté les frères Blancs, ces jumeaux qui avaient piraté avec succès le réseau du télégraphe optique pour connaître en primeur le cours de la bourse [p. 48]).
Mais ce plaisir du récit tel qu’il est mis en œuvre tient aussi au type d’objet raconté ; ceux-ci ont en effet tous à voir avec des fantasmes, des peurs, le jouissif de la caricature ou l’ingéniosité (celle, par exemple, qui fait dérailler un système de communication dont l’unique rôle était d’informer rapidement les autorités de la montée de troubles pour faciliter leur répression [p. 45]). Peut-être ce plaisir est-il donc autorisé par l’éloignement temporel et le caractère apparemment anodin de ces productions (pas de « complotisme antivax » ou de propagande nazi). Il a en tout cas à notre sens le grand mérite d’ouvrir la possibilité de s’interroger à son endroit. Une hypothèse explicative pessimiste peut aussi suggérer qu’il s’agit d’un plaisir de supériorité, celui qui émerge lorsque l’on se sent averti, à distance de ce qui est perçu comme un ensemble de phénomènes relevant de la crédulité naïve. Toutefois, dans la mesure où il invite le lecteur à observer ses propres schèmes d’appréhension vis-à-vis des objets de la circulation médiatique, ce plaisir de la lecture enjoint probablement à considérer sa propre perméabilité aux caractéristiques de ces faussetés anciennes et modernes entre lesquelles se crayonnent des parallèles. En cela, ce plaisir de lecture semble être un adjuvant à cette entreprise du « voir le vrai dans le faux et le fictif » précédemment décrite et, sans y voir la source d’un nivelant relativisme, celui-ci génère possiblement un effet déstigmatisant ou déhiérarchisant quant aux produits médiatiques étudiés.
(1) Le Monde, 11 janvier 2017.
(2) Le pseudonyme fait office de résurrection d’un journaliste n’ayant jamais existé, une résurrection seconde, puisqu’il s’est déjà ranimé pour un premier livre : Faire sensation. De l’enlèvement du bébé Lindbergh au Barnum médiatique, Marseille, Agone, 2017. Roy Pinker était ainsi le correspondant américain inventé dans l’entre-deux-guerres pour la rubrique faits-divers du journal Le Détective, créé par Gallimard.
(3) On peut citer une série d’exemples aux points de vue variés, mais les études sont trop nombreuses et diverses pour en faire état ici : Paul Mihailidis et Bobbie Foster, “The Cost of Disbelief: Fracturing News Ecosystems in an Age of Rampant Media Cynicism”, dans American Behavioral Scientist 65, no. 4, 2021, p. 616–31 ; Sophie Jehel et Alexandra Saemmer, Éducation critique aux médias et à l’information en contexte numérique, Villeurbanne, Presses de l’Enssib, coll. « Papiers », 2020 ; https://doi.org/10.1177/0002764220978470. Andrew Guess, Jonathan Nagler, Joshua Tucker, “Less than you Think: Prevalence and Predictors of Fake News Dissemination on Facebook.”, Science advances, vol. 5,1, 2019. DOI : 10.1126/sciadv.aau4586. ; Soroush Vosoughi, Deb Roy, Sinan Aral, « The spread of true and false news online”, Science, vol. 359, n° 6380, 2018 ; Romain Badouard, Le Désenchantement de l’internet. Désinformation, rumeur et propagande, Limoges, éd. FYP, 2017.
(4) Nous formulons la même remarque que supra : les travaux mentionnés s’inscrivent dans des perspectives qui spécifient chacune la démarche historique selon une problématisation propre. On citera donc à titre illustratif : Brian Winston et Matthew Winston, The Roots of Fake News: Objecting to Objective Journalism, London, Routledge, 2021 ; Phillipe Bourdin et Stéphane Le Bras (dirs.), Les fausses nouvelles. Un millénaire de bruits et de rumeurs dans l’espace public français, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal, 2018 ; Pascal Froissart, La rumeur. Histoire et fantasmes, Paris, Belin, 2002. L’ouvrage de Roy Pinker renvoie de son côté en introduction à des travaux ayant mis en évidence la qualité virale des sociétés médiatiques aux XVIIIe et XIXe siècles : les études de Slauter, Pinson, Conon, Cordell sont ainsi renseignées p. 14.
(5) Cette observation est également formulée par Benoît Crucifix : « Roy Pinker, Fake News & viralité avant Internet », Lectures, Les comptes-rendus, 2021. URL : http://journals.openedition.org/lectures/47780.
(6) Les Lois de l’imitation, étude sociologique, 2e éd., Paris, Félix Alcan, 1895.
(7) Nous restons surprise par l’opposition nette qui est formulée entre reprise et création. Si l’on comprend que le copier-coller est une pratique peu innovante (quoique, passer d’un contexte à un autre peut en effet créer de nouvelles conditions d’interprétations ou donner, par les différents procédés de montage qui en résultent, d’autres effets de sens en fonction des occurrences), l’ouvrage participe selon nous régulièrement à mettre en évidence la fécondité et de l’inventivité de ces pratiques de reprise et de leurs contenus. Un contraste se crée alors entre cette hiérarchisation des pratiques du faux (l’intentionnellement trompeur n’a pas la même valeur que l’ironie et la parodie) et, sans vouloir tomber par ailleurs dans un relativisme absolu, les phénomènes de contagion entre ces pratiques tels qu’ils sont mis en lumière dans la description (voir infra).
(8) La Croyance astrologique moderne, Paris, L’Âge d’homme, 1982.
(9) On pointera par exemple, dans les pages dédiées au placement de produit, le savoureux jeu parodique entre une série de réclames pour un shampoing anti-poux dramatisées en faits divers (« Un million de victimes », « Condamnées à mort », « Fâcheuse Rencontre dans un Train ») et l’annonce d’un roman d’anticipation « La guerre des mouches » (ch. X).
(10) Voir en particulier à ce propos le parcours effectué dans l’introduction à partir de la rumeur des lapins du Père-Lachaise.
(11) On pourra consulter à ce sujet le chapitre IV, dédié aux nouvelles parodiques et leur capacité à inventer, dans la connivence sociale, un contre-monde.
(12) Carlo Ginzburg, Le fil et les traces : vrai, faux, fictif, Lagrasse, Verdier, 2010, p. 12-13.
(13) Voir à ce propos les travaux menés en analyse du discours sur les « énoncés détachés » ou les « petites phrases » (Dominique Maingueneau) et sur la notion d’« événement discursif » (Laura Calabrese).
(14) Celui-ci appartient généralement au XIXe siècle, ce qui s’explique probablement par la récente observation selon laquelle « les reprises de textes et d’image, d’un journal à l’autre, prenaient dès le XIXe siècle une ampleur considérable, en partie facilitée par l’application très faible des droits de propriété intellectuelle » (p. 215).
(15) Crucifix, art. cit. et Sylvain Doussot, « Pinker, R. (2020). Fake news & viralité avant Internet. CNRS Éditions », Revue des sciences de l’éducation 47, no 2, 2021, p. 281–283. https://doi.org/10.7202/1083991ar.