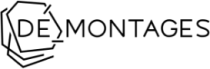À l’invitation du Théâtre de Liège, j’ai participé, avec Geoffrey Grandjean (ULiège) et Vincent Aerts (ULiège), à l’animation d’une séance de « Réflexions partagées » à destination d’un public d’enseignant·es. Le service pédagogique du théâtre propose en effet aux écoles de préparer la discussion du spectacle avec les élèves par un échange autour des problématiques traitées. Le spectacle concerné s’intitule Extreme/Malecane, mis en scène par Paola Pisciottano et aborde la question de la banalisation des idées extrémistes. Mon intervention a notamment porté sur la définition de ce qu’on appelle un « discours extrême » et sur les affinités supposées entre ce type de discours et les médias numériques.
Qu’est-ce qu’un « discours extrême » ?
La qualification d’un discours en tant que « extrême » peut s’appuyer spontanément sur une approche externe, qui consiste à rapporter tel discours aux acteurs sociaux qui le portent ou qui s’y reconnaissent : individus, groupes, partis, identifiés préalablement comme étant situés aux « extrêmes » de l’éventail idéologique d’un état de société. Ce type d’approche s’intéresse donc moins au discours lui-même qu’à la position de celui qui l’énonce.
Si l’on cherche à caractériser le discours lui-même, on s’intéressera prioritairement à ses « contenus », c’est-à-dire aux idées et opinions exprimées, et singulièrement aux cibles visées par ces contenus : un discours sera dit alors « discours de haine » s’il énonce des choses qui sont en-dehors du dicible admis par un état de société, en particulier parce que ces choses énoncées portent potentiellement atteinte à certains membres de ladite société. Le Conseil de l’Europe entend ainsi par « discours de haine » « tout type d’expression qui incite à, promeut, diffuse ou justifie la violence, la haine ou la discrimination à l’encontre d’une personne ou d’un groupe de personnes, ou qui les dénigre, en raison de leurs caractéristiques personnelles ou de leur statut réels ou attribués telles que la “race”[1], la couleur, la langue, la religion, la nationalité, l’origine nationale ou ethnique, l’âge, le handicap, le sexe, l’identité de genre et l’orientation sexuelle. » En France, la loi portée par Laetitia Avia (dite « Loi Avia ») se propose de « lutter contre les contenus haineux » sur internet ; elle s’est heurtée en juin 2020 à d’importants obstacles juridiques : beaucoup de ses aspects furent jugés anticonstitutionnels. Il parait en effet périlleux d’établir de manière stricte un périmètre thématique de « la haine » qui pourrait faire l’objet d’une condamnation, et l’énumération des motifs de haine semble potentiellement infinie.
Face à ces difficultés définitionnelles, plusieurs travaux en analyse du discours cherchent à approcher les discours de haine dans le cadre plus large des phénomènes de violence verbale (voir notamment Rosier [dir.] 2012 ; Monnier & Seoane 2019 ; Lorenzi Bailly & Moïse 2021). L’enjeu n’est alors plus tant de cerner les « contenus » haineux que les « formes » par lesquels ils s’expriment en discours. Ces formes sont complexes et multiples. Elles ne se laissent pas ramener à une check-list qui permettrait à coup sûr de repérer un discours de haine ; elles composent plutôt un éventail de marques et de niveaux d’observation possibles, qui invite surtout à se rendre sensible à certains principes de fonctionnement des discours – même ceux que l’on ne qualifierait pas spontanément de « haineux » par leurs contenus ou par l’identité de leur source.
Ces marques discursives peuvent concerner ce que la rhétorique nomme l’éthos, c’est-à-dire l’image qu’un locuteur construit de lui à travers son discours (sur cette notion, voir notamment Amossy 2010). Dans le cas des discours de haine, cette image, qui est donc bien une construction discursive, pourra ainsi convoquer des effets d’autorité (lorsqu’on s’énonce en détenteur d’une vérité indiscutable, ou qu’on se réfère à des sources supposées « faire autorité ») ; elle pourra correspondre à la figure archétypale du « prophète » (lorsqu’on prétend savoir à l’avance ce qui va arriver) ; elle pourra encore se construire à partir des valeurs d’« authenticité » et de « liberté (d’expression) », au nom desquelles une parole impose sa nécessité et sa légitimité dans un débat.
Symétriquement aux marques relatives à l’éthos, on trouvera des marques qui construisent l’Autre du discours : non plus sa source, mais sa cible, ou son en-dehors. Comme on l’a dit, une approche discursive cherchera moins à lister les identités des groupes sociaux pris pour cibles (personnes racisées, porteuses de handicap, identités de genre marginalisées, etc.), qu’à identifier les procédés par lesquels ces identités sont construites en discours. Trois procédés sont particulièrement saillants et convergents : la stéréotypie (qui consiste à réduire un groupe social à quelques traits jugés définitoires : « les Italiens sont des tricheurs »), l’essentialisation (qui consiste à faire de cette définition une vérité absolue, valable en tous temps et en tous lieux), et la métaphorisation (qui permet de construire l’image de l’Autre en l’alimentant des représentations qu’on se fait d’une autre sphère d’expérience ; même parler « innocemment » de « vagues de migrants » ou de « jungle de Calais » s’appuie sur des représentations qui orientent notre perception des sujets traités).
Un troisième type de marques peut paraitre paradoxal dans le cadre des discours de haine ou de violence verbale, dans la mesure où il concerne l’apparente rationalité de ces discours. On associe spontanément la rationalité à la norme d’un « bon » fonctionnement du discours ; or, les marques de la rationalité peuvent aussi servir des effets d’autorité et constituer les instruments d’une violence verbale qui ne dit pas son nom. Ainsi, l’abondance du recours à l’idée de « preuve (irréfutable) », la clôture logique affichée (« CQFD »), ou la qualité d’« évidence » ou de « bon sens » attribuée à ce qu’on énonce, peuvent constituer des marques discursives de rationalité qui, au contraire de favoriser une mise en débat, placent d’emblée tout contradicteur dans une position risquée, sinon impossible.
Un discours n’est jamais un objet clos sur lui-même : il convoque de manière plus ou moins explicite des fragments d’autres discours plus ou moins proches, auxquels il répond, ou desquels il réactive la puissance imaginaire. Sur ce quatrième plan d’analyse, qui concerne donc ce qu’on nomme l’interdiscours, on se demandera ainsi à quelle mémoire collective se rattache tel discours, par certains des mots qu’il emploie, ou par certaines des références qu’il mobilise. Par exemple, parler d’un mouvement social en disant qu’il s’est « radicalisé » convoque l’interdiscours du radicalisme religieux et de la violence terroriste.
Une cinquième marque, plus transversale, concerne ce qu’on appelle la performativité du discours. Ce concept relève d’un cadre théorique, la théorie des actes de langage, proposé notamment par le philosophe John Austin dans son livre pionnier Quand dire, c’est faire. Selon Austin, le langage ne sert pas qu’à communiquer des informations, mais aussi à réaliser des actions très concrètes. Parmi ces actes qu’on réalise en utilisant le langage, Austin distingue les actes performatifs : lorsque l’usage même de la parole produit un changement dans l’état des choses. L’exemple typique de la performativité est celui de « Je vous déclare mari et femme » : une fois cet énoncé prononcé (dans certaines conditions), l’état des choses a effectivement changé pour les personnes concernées. Si la notion de performativité est rapprochée des discours de haine, c’est bien parce que ces discours prétendent bien avoir des effets concrets sur le monde qui les entoure : désigner des victimes, des coupables et des bourreaux, pousser à l’action violente, ou susciter une perception de la réalité qui va justifier certains comportements. Par exemple, on peut considérer que la célèbre phrase « Nous sommes en guerre » répétée par le Président Macron au début de la pandémie de Covid-19 a eu des effets performatifs.
Enfin, les développements récents en sciences du langage ont remis à l’avant-plan l’importance de la composante émotionnelle dans la mécanique rhétorique des discours (voir notamment la synthèse de Micheli 2014, ou ce dossier de revue sur « l’appel à la pitié dans l’espace public »). À côté des approches psycho-sociologiques des émotions, il y a bien une place pour une étude rhétorique des marques par lesquelles l’émotion se construit en discours, et participe des effets d’adhésion que peut produire un discours – c’est ce que la tradition rhétorique nomme depuis Aristote les effets de pathos.
Ces marques peuvent être plus ou moins évidentes, lorsqu’elles concernent le lexique employé. Certains mots d’une langue sont en effet chargés d’une composante émotionnelle, dysphorique ou euphorique, qui est convoquée dans ce qu’on nomme des « énoncés d’émotion », ou de « l’émotion dite » : l’énoncé Je déteste les étrangers exprime explicitement, par le verbe détester, un affect négatif qu’on peut rapporter au locuteur et qui désigne en outre son objet.
Mais les marques d’émotion peuvent apparaitre de manière plus latente, lorsqu’elles concernent non plus l’énoncé, mais l’énonciation, c’est-à-dire lorsqu’elles qualifient l’action de production de l’énoncé. Un débit de parole très rapide ou très hésitant, un volume sonore s’écartant de la normale, un usage surabondant ou au contraire minimal des signes de ponctuation à l’écrit, l’emploi de certains émoticônes dans la communication numérique : tous ces phénomènes peuvent être considérés comme des marques énonciatives de l’émotion, dans la mesure où ils montrent (plus qu’ils ne disent) l’état émotionnel de la source d’énonciation. Qu’elles dites ou montrées, ces marques d’émotion qui réfèrent au locuteur-source ont des effets sur son éthos : elles contribuent à l’humaniser, et à y attacher des valeurs d’« authenticité » ou de « franc-parler ».
Enfin, l’émotion en discours peut se construire également par le biais d’un récit : raconter un événement ou une situation de manière à y associer une réaction émotionnelle plus ou moins conventionnelle, ou culturellement attendue. Le récit émotionné, parce qu’il met en place une petite dramaturgie, permet aussi d’attribuer des rôles, et d’orienter ainsi la perception qu’on se fait d’une part de la réalité. Les récits médiatiques de conflits guerriers activent très souvent une composante émotionnelle, en même temps qu’ils nous invitent à lire le réel à l’aune d’un scénario plus ou moins canonique (opposant par exemple les Bons aux Méchants).
L’émotion en discours voit ses effets potentiellement accentués lorsque la pratique discursive s’inscrit dans un rituel (tel par exemple la « grand-messe » médiatique que constitue encore un peu le JT du soir), c’est-à-dire se trouve répétée, codifiée, partagée par une communauté, reconnue à travers des manières d’être et de dire relativement uniformisées.
Aborder les discours de haine par le biais de ces outils d’analyse des émotions peut permettre d’éviter de se contenter de les diaboliser, pour tenter plutôt de comprendre les mécanismes d’adhésion qu’ils suscitent, en les rapportant aussi à des logiques discursives à priori moins illégitimes, ou en tout cas non limitées à des « niches » toxiques. Le succès de certains discours de haine ne peut pas s’expliquer par un isolement ou une marginalisation en-dehors de l’ordre du discours légitime, mais oblige à interroger les intersections entre le fonctionnement jugé « ordinaire » du discours, et ses usages jugés « déviants ».
[1] Tous les êtres humains appartenant à la même espèce, le Comité des Ministres rejette, comme le fait la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), les théories fondées sur l’existence de différentes « races ». Toutefois, dans ce document, il utilise le terme « race » afin d’éviter que les personnes qui sont généralement et faussement perçues comme « appartenant à une autre race » soient exclues de la protection prévue par la législation et de la mise en œuvre de politiques de prévention et de lutte contre le discours de haine.
Internet est-il un terreau fertile pour les discours de haine ?
Dans la section précédente, nous avons apporté quelques pistes de caractérisation discursive des phénomènes de violence verbale. Or, tout discours est aussi fortement conditionné, dans sa production comme dans ses effets, par les supports médiatiques qu’il emprunte pour circuler. À cet égard, les réseaux socio-numériques (RSN), et plus largement internet, sont fréquemment pointés du doigt en tant qu’ils favoriseraient l’expression de contenus haineux (la loi Avia évoquée plus haut adopte clairement cette perspective).
Les RSN ne sont pas par nature la source du Mal ; il convient plutôt de chercher à comprendre quelles caractéristiques techno-discursives de ces dispositifs (voir notamment Paveau 2017, ainsi que le carnet de recherche sur les « technodiscours ») encodent des possibilités expressives particulières, et pour quelles raisons.
Quatre traits sont fréquemment mis en évidence pour qualifier la spécificité de la communication numérique et sa prédisposition à la violence verbale (voir Monnier et al. [2021]) : la facilité de l’anonymat, la brièveté des formats, la valorisation de l’hyper-réactivité, l’hétérogénéité des flux agrégés sur un même dispositif de visualisation et d’écriture (un fil Twitter peut en effet mêler sur un même plan des contenus de natures à priori très différentes).
À cela s’ajoute que les dispositifs numériques valorisent ce qu’on pourrait considérer à priori comme les marges d’un discours, ou son escorte paratextuelle : sur YouTube, les commentaires (et même parfois le nombre de commentaires) importent souvent davantage que le contenu de la vidéo postée (voir par exemple le travail de Nelly Quemener [2022] sur la chaîne YouTube de Dieudonné) ; sur Twitter, les “simples” outils d’indexation et de republication que constituent les hashtags et les retweets appartiennent désormais au répertoire des pratiques politiques (voir par exemple le travail de Maxime Cervulle et Fred Pailler [2015] sur les débats autour du « Mariage pour tous » sur Twitter).
Ces différentes caractéristiques techno-discursives produisent potentiellement des effets performatifs, qui débordent la simple « publicité » faite aux idées ou à l’identité d’une communauté pré-existante : elles peuvent en effet contribuer à la formation de « communautés émotionnelles », unies autour de quelques noyaux d’« intensités affectives ». Elles réalisent aussi ce qu’on peut appeler une « performance de valeurs », qui contribue à fixer les modalités de réaction pertinente à certains types de contenus. Enfin, elles favorisent la hiérarchisation des sujets dignes d’intérêt et participent ainsi à la configuration de nos seuils d’attention quand nous utilisons ces dispositifs (sur ces différents aspects, voir Quemener 2022).
Dans ces conditions, peut-on raisonnablement adopter une position purement éthique sur les usages du numérique, en plaidant par exemple pour une « citoyenneté numérique », ou en établissant des normes de « bon usage » du numérique ? Cette position parait difficilement tenable dès lors qu’elle place les usagers dans une sorte d’injonction contradictoire : sans remettre en question l’impératif participatif qui sous-tend les dispositifs numériques (« participez à la culture numérique ! » ; voir Proulx 2017), elle cultive dans le même temps une attitude de méfiance et de responsabilité individuelle (« faites attention ! »).
Ainsi la posture éthique gagne-t-elle à se compléter d’une critique des logiques économiques qui soutiennent les dispositifs numériques et en commandent les affordances. On désigne par ce terme les traits formels par lesquels un dispositif rend plus ou moins disponible et plus ou moins valorisée tel type d’action – typiquement : le bouton « J’aime » sur Facebook. Comme on le voit par cet exemple, les affordances numériques exploitent tout particulièrement nos dispositions affectives : on retrouve ici la question des émotions. Ce lien entre les dimensions économiques et affectives du fonctionnement du Web est au cœur des courants critiques portant sur les nouvelles formes du capitalisme à l’ère des plateformes (sur ces aspects, voir Jehel & Proulx 2020). Cette critique s’appuie sur le concept de « travail numérique » : les usagers du Web produisent de la valeur par le biais du clic et du comptage dont il fait l’objet. Ce travail est stimulé par l’hypertrophie du rapport affectif aux contenus numériques : ce qui circule, ce sont moins ces contenus eux-mêmes que l’investissement émotionnel dont ils font l’objet (« J’aime »). Ces émotions rendues publiques ne correspondent pas forcément à la « vérité » psychologique des individus qui les expriment (voir à ce propos le concept d’extimité proposé par Serge Tisseron [2011] : « processus par lequel des fragments du soi intime sont proposés au regard d’autrui pour validation »), mais elles leur sont pourtant bien imputées, et ils en sont tenus pour responsables. Tout cela implique dès lors chez les usagers un lourd « travail émotionnel » (Hochschild 2017), qui consiste à calquer ses réactions au niveau d’intensité affective attendu au sein de la communauté liée au dispositif utilisé.
La diabolisation des discours de haine sur internet s’empêche ainsi d’interroger les soubassements inséparablement économiques et affectifs des dispositifs de communication numérique. C’est en analysant de près les caractéristiques technodiscursives de ces dispositifs qu’on peut dépasser la simple condamnation des « contenus », pour mieux comprendre en quoi ces « contenus » sont en quelque sorte prédisposés par des formes qui font converger la rentabilité économique et l’intensité de l’engagement affectif.
Retour au théâtre
Ces éléments de réflexion sur les dispositifs numériques nous permettent peut-être de comprendre aussi un peu mieux la démarche de création théâtrale mise à l’œuvre dans le spectacle Extreme/Malecane. Ce spectacle va à priori à l’encontre des mots d’ordre « citoyens » visant à faire taire les discours extrêmes, puisqu’il choisit délibérément de s’en faire le porte-voix : les personnages qui se présentent à nous de manière ordinaire en viennent progressivement à exprimer des opinions qui dérangent, sur le port d’armes, sur l’accueil des étrangers, sur l’identité nationale.
Le premier intérêt d’une telle démarche est précisément d’éviter la diabolisation à priori, consistant à refouler l’extrémisme dans un sous-sol glauque et monstrueux : « l’extrémisme, c’est l’Autre ». Le spectacle choisit plutôt de montrer que ces discours sont proches de nous, collent à notre vécu le plus banal, sont tissés d’un fil qui les lie à de l’humain dans son sens le plus large.
Le deuxième intérêt est que cette banalité de l’extrême est saisie par le biais d’une démarche d’enquête : les paroles incarnées sur scène ont été prononcées lors d’entretiens avec des jeunes de différents pays d’Europe. Les personnages apparaissent ainsi davantage comme des témoins que comme des coupables, et l’on peut supposer que le processus de l’enquête elle-même a produit des effets transformateurs auprès de celles et de ceux qui y ont participé.
Enfin, surtout, en adoptant le langage de la mise en scène théâtrale, le spectacle opère une re-médiation à l’endroit de ces discours, c’est-à-dire les transpose dans un support médiatique (en l’occurrence, la mise en scène théâtrale) à priori incongru, ou en tout cas étranger aux canaux qui lui seraient plus familiers (singulièrement les canaux de la communication numérique).Cette re-médiation implique notamment une mise en corps et une mise en voix, qui rompent totalement avec la parole désincarnée et muette des réseaux socio-numériques, et qui révèle ainsi par contraste, et par excès, les liens que ces discours extrêmes entretiennent avec les émotions et la vulnérabilité des individus qui s’exposent à nous. En s’exposant à nous sur une scène, ils nous invitent du même coup à nous situer face à eux et à mesurer la part d’humanité que nous acceptons de leur reconnaitre.