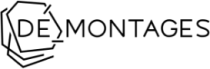Intervention publiée initialement sur le site Diacritik, le 7 décembre 2020, à cette adresse.
C’est un exercice périlleux que de chercher à dire encore « quelque chose d’intelligent » sur Hold-up, après la somme de « discours critiques » produits depuis la sortie de ce film. Si mon propos assumera la fonction d’une « déconstruction », il s’agira moins d’une déconstruction de la mécanique du film à partir d’une position extérieure immunisée, que d’une déconstruction de cette position extérieure immunisée, au profit d’une autre posture de commentaire.
L’un des gestes quasi automatiques des postures critiques qui se sont appliquées à Hold-up a consisté à coller l’étiquette « conspirationniste » sur ce film. À partir d’une position de savoir assurée sur ce qu’est le conspirationnisme, sur ce que sont ses « procédés fallacieux », sur les normes auxquelles doit répondre un « discours de vérité », il s’agit de recouvrir toutes les lectures possibles du film d’un même label qui les discrédite d’emblée. Car si le film est « fake » ou « fallacieux », alors celles et ceux qui le regardent, le partagent, s’en émeuvent, s’y retrouvent, sont eux-mêmes, au mieux de pauvres esprits manipulés, des cibles faciles pour la vaste entreprise de duperie, au pire des conspirationnistes qui alimentent et adhèrent sciemment à une vision du monde fondée sur l’irrationalité et les contre-vérités. Autrement dit, la critique consistant à partir du diagnostic de « film conspirationniste » disqualifie par avance toute expérience spectatorielle, à partir d’une position d’expertise sûre d’elle-même et du partage qu’elle institue, à son seul profit, entre le légitime et l’illégitime, entre le « bon » spectateur critique, et le « mauvais » spectateur manipulé ou complotiste lui-même.
De son côté, le film adopte exactement la même logique de qualification a priori du spectateur, en lui donnant une sorte de virginité éthique et une consistance politique reconnue : le label utilisé est ici celui du « citoyen », comme concentré de toutes les valeurs qui définissent normalement une société démocratique et comme figure réalisant par défaut l’idéal de participation à la chose politique, tant prôné par lesdites sociétés démocratiques. L’un des premiers cartons de Hold-up annonce qu’il s’agit d’« un film citoyen », et le générique de fin affiche quant à lui la longue liste des internautes qui ont participé au financement du film. Le film est ainsi encadré par ces marges paratextuelles qui instituent un contrat énonciatif et, par miroir, une posture spectatorielle légitime : des citoyens parlent aux citoyens. Au passage, on se souviendra que ce label de « film citoyen » avait déjà été revendiqué par le célèbre documentaire Demain (Cyril Dion & Mélanie Laurent, 2015), César du meilleur film documentaire en 2016. Le citoyen correspondrait ainsi à l’instance pure de toute compromission, guidée par le bon sens et par les intérêts collectifs de l’humanité universelle, ancrée dans une expérience concrète des réalités quotidiennes, et mue par une soif de vérité prête à affronter tous les faux-semblants dont elle a pu par ailleurs être elle-même la victime ou l’instrument.
Ces étiquettes posées à priori – d’une part le « manipulé » ou le « conspirationniste », d’autre part le « citoyen » – jouent en réalité le même jeu d’un recouvrement de l’expérience spectatorielle par des catégories qui la surchargent de valeurs, qui renvoient dans tous les cas les spectateurs réels à une passivité totale, à une pure vacuité prête à être remplie de « manipulation », « conspirationnisme », ou « citoyenneté », sans chercher à saisir les formes qui, concrètement, dans la matière même du film, construisent elles aussi une figure de spectateur, qui n’est jamais aussi monolithique que ce que laissent penser les verdicts de « manipulé », « conspirationniste » ou « citoyen ».
On peut en effet s’attacher aux traits du spectateur construit de l’intérieur par Hold-up, pour en dégager le modèle spectatoriel qui est activé par ce film – de la même manière qu’on parle en littérature d’un « lecteur-modèle » pour désigner le profil du lecteur tel qu’il est construit par le texte (un roman policier n’a pas le même lecteur-modèle qu’un poème symboliste). Pour parler de ce spectateur-de-Hold-up, j’utiliserai la première personne du singulier : d’une part pour signifier que le portrait qui se dégage me correspond en bonne part, ou correspond à mes proches, mes amis, ma famille, mes collègues – et que j’écris ici à partir de l’inconfort que suscite chez moi cette reconnaissance –, d’autre part pour signifier que ce portrait n’est pas dessiné par Hold-up à partir d’une page blanche, mais qu’il recycle des éléments préexistants, qu’il s’élabore en quelque sorte à partir de moules spectatoriels préconstruits.
Je suis donc le spectateur de Hold-up.
Pour décrire le miroir que me tend ce film, je distinguerai grossièrement trois volets, trois types de traits : des traits sociologiques, des traits affectifs, et des traits que je qualifierais d’encyclopédiques, qui correspondent en gros à l’imaginaire culturel dans lequel je me reconnais. Il va de soi que cette tripartition est artificielle et que, dans les faits, tous les ingrédients sont mêlés.
Sociologiquement, je fais partie de ces gens dont le niveau d’éducation les amène à accorder du crédit au savoir scientifique. Le savoir médical en particulier est l’affaire de spécialistes, dont certains ont acquis une autorité dans leur domaine, et dont les opinions peuvent légitimement apparaitre comme des avis autorisés sur la question de la transmission du virus, sur son origine ou sur son traitement. Le film me montre ces spécialistes, et les titres qui valident leur expertise médicale. Ma sensibilité intellectuelle me permet aussi de reconnaitre que les questions médicales ne sont pas seulement l’affaire de la médecine : quand on me présente un « anthropologue de la santé », je suis prêt à donner un sens à ce point de vue, à reconnaitre qu’il y a bien aussi une vérité anthropologique à entendre sur les questions sanitaires – ce qui est loin d’être évident. Mon frère travaille pour une entreprise pharmaceutique, et il apparait souvent sceptique face à mes considérations anthropologiques sur des réalités qu’il considère comme relevant de la pure objectivité des sciences dures. Je suis content que le documentaire fasse droit à ce type de regard plus « sciences humaines ».
Mais je ne suis bien sûr pas qu’un intellectuel : je suis aussi un père de famille, à qui il est déjà arrivé de prendre le taxi, qui aime boire des verres en terrasse, qui a une cousine infirmière, et dont les parents ont applaudi le personnel médical tous les soirs à 20h lors du premier confinement. Les chauffeurs de taxi ne sont peut-être pas Prix Nobel, mais ils ont souvent une acuité de regard et un franc-parler rafraichissants. D’ailleurs, j’aime engager la conversation avec eux quand je me retrouve dans une ville étrangère. Oui, j’aime aussi boire des verres en terrasse, et je n’aime pas qu’un policier m’interrompe dans cette activité. Ma sensibilité politique me conduit d’ailleurs à être assez critique envers toutes les formes de répression policière, dont l’actualité me fournit quotidiennement plusieurs exemples. En revanche, je me sens plus proche des revendications du personnel soignant, dont on a tellement dit dans les médias qu’il était « en première ligne ». Le discours de la sage-femme ou des médecins de terrain me touchent parce qu’ils rendent compte d’expériences de travail concrètes, de souffrances humaines situées. La sage-femme est par ailleurs sans doute aussi une mère : quand elle demande « Qu’est-ce qu’on va dire à nos enfants ? », cette question résonne avec mes propres angoisses de père. On touche là déjà à des composantes affectives du portrait.
Mais avant de passer à ce deuxième volet, je veux encore pointer quelques traits sociologiques activés par l’instance d’énonciation du film lui-même.
Le réalisateur est un homme ; son visage apparait à plusieurs reprises. Il porte un pull Ralph Lauren et utilise un ordinateur Apple. Il dit à un moment donné « Un médoc qui a roulé sa bosse ». Il sourit parfois à certains propos des témoins ; sinon, il prend un air sérieux et pénétré. Je ne partage pas l’ensemble de ces traits, mais ils me disent tout de même quelque chose de mon monde, et en font le monde à partir duquel le film se représente en tant que film : un monde dominé par une bourgeoisie masculine blanche, qui sait de quoi on peut rire ou pas, qui sait quel degré de relâchement elle peut s’autoriser dans le registre de langue qu’elle utilise pour rester comprise par qui elle veut être comprise.
Certaines des composantes sociologiques de ce portrait correspondent à des réactions émotionnelles. En tant que spectateur de Hold-up, je suis construit par une palette d’affects particulière, c’est-à-dire que le film me dit ce que je suis censé ressentir, en exploitant précisément chez moi des zones sensibles. Cette sensibilité affective me situe tout autant que la sensibilité sociologique : elle m’inscrit dans un parcours dont je reconnais les principales balises, pour les avoir en fait déjà expérimentées, et justement en lien avec la crise sanitaire et sa médiatisation.
Si j’ai parlé de parcours, c’est qu’il me semble qu’il y a bien une syntaxe des affects dans Hold-up, c’est-à-dire une manière de les combiner l’un à l’autre pour former un ensemble, et surtout pour conduire à une dominante affective générale. Pour parler encore le vocabulaire de la syntaxe, je dirais que les émotions particulières sont régies par une émotion générale. Quelles sont ces émotions dans lesquelles me (re-)place Hold-up ?
Il y a d’abord la sidération : comme beaucoup de gens, la crise sanitaire, les mesures politiques et les discours médiatiques qui l’ont accompagnée m’ont littéralement sidéré, c’est-à-dire ont brutalement fait vaciller tout ce qui donnait forme à ma vie, en me confrontant, à répétition, à des situations et des représentations qui semblaient juste avant tout bonnement impossibles à concevoir. Le film mise sur cet affect de sidération, en m’invitant à le recharger, comme on gratterait une croûte encore suintante : ça fait mal, mais on le fait quand même. Oui, c’est incroyable ce que nous avons vécu et vu depuis la mi-mars, et non il n’y a pas de raison à ce que la sidération ne puisse pas à nouveau agir sur moi : d’ailleurs la tonalité des témoignages est là pour me rappeler à cet affect qui fut si prégnant.
En deuxième lieu, il y a la colère. Oui, j’ai été en colère contre mes dirigeants politiques, et même contre mon propre employeur, face à leur manière de gérer cette crise, et face au pouvoir qu’ils exerçaient sur ma vie et celle des autres. Cette colère alimente la défiance envers tous les signes qui manifestent potentiellement de la contrainte et qui justifient cette colère : pourquoi diable des panneaux signalétiques en métal obligeant le port du masque dans les rues ? Le film réactive là encore cette configuration affective bien rôdée : je suis en colère contre ce qui m’arrive, et ma seule arme de résistance est d’exercer un doute systématique sur ce qui alimente cette colère, tout simplement pour la justifier, pour lui donner une cible. Le film cartographie le territoire potentiel des colères et des cibles qui y correspondent.
Cependant, un affect négatif comme la colère a besoin d’une contrepartie positive. Je ne suis pas un colérique ; je ne m’emporte pas facilement. Le fait de me sentir durablement en colère m’indispose. Cet affect ne peut pas occuper tout mon champ émotionnel. Durant la crise sanitaire, il a pu trouver son contrepoint dans un autre affect important, lui aussi très présent dans le film et déjà évoqué tout à l’heure : la pitié. La représentation de la souffrance d’autrui est un lieu commun médiatique particulièrement représenté lors de cette crise sanitaire. J’ai été affecté par le compte journalier du nombre de morts, par le spectacle des hôpitaux débordés, par les témoignages du personnel soignant ; j’ai été affecté par les conditions de travail et de vie des caissières, des aide-ménagères, des étudiant.es durant le confinement ; j’ai été affecté par les privations subies par les enfants. Le film me retend ce miroir affectif, quand il me montre des médecins dont la voix tremble, une sage-femme qui s’interrompt pour pleurer, ou des regards vides à force d’avoir trop vu. Je me reconnais dans ce paysage d’affects, et je m’y plonge sans me demander une seule seconde si ce qu’on me dit est vrai ou faux – tout simplement parce que la vérité de l’affect me suffit, et parce que j’y reconnais, portés à un point d’intensité, des affects abondamment relayés dans les JT depuis des mois.
Enfin, le dernier affect massif que j’éprouve face à Hold-up est la peur. Ce que me dit et me montre ce film m’effraie, tout comme m’ont effrayé les déclarations télévisées du conseil national de sécurité, tout comme m’ont effrayé les articles lus quotidiennement dans la presse, tout comme continue de m’effrayer l’actualité politique mondiale de manière générale. Oui, j’ai peur du monde tel qu’il va, et Hold-up le sait : le visuel de son affiche, omniprésente à l’arrière-plan, reprend d’ailleurs les codes visuels des films d’épouvante (type Saw ou Hostel), de la série dystopique (type Black Mirror) ou des thrillers littéraires (type Michael Crichton), et me promet ainsi de faire droit à cette peur, de lui donner une place et des raisons d’être, en élargissant la zone de l’insécurité à des dimensions globales. Hold-up me saisit donc par le bout de ma peur pour me placer dans une histoire qui l’amplifie et qui, en somme, en vient à subordonner tous les autres affects : la peur est l’émotion rectrice, car elle m’empêche de faire autre chose de ma sidération, de ma colère ou de ma pitié, que des épi-phénomènes de la peur : je comprends avec Hold-up que mes raisons d’être sidéré, en colère ou empathique étaient bien légitimes, mais ignoraient encore la raison supérieure qui s’impose à toutes les autres : cette histoire est bien plus effrayante que je ne le pensais.
Ce flot d’affects dans lequel je suis pris m’abîme littéralement : la traversée des confinements m’a déjà pas mal abîmé ; Hold-up m’achève : la surcharge émotionnelle fait que je ne m’appartiens plus, dépossédé de moi-même, « je suis perdu », comme le dit la voix-off du film. Pétrifié par l’ampleur du désastre qui vient, j’abandonne tout espoir de trouver encore une prise politique qui soit pertinente à mon échelle. La seule prise que j’ai encore consiste à partager le lien du documentaire, pour que d’autres enfin me rejoignent dans l’abîme émotionnel des « citoyens-qui-savent ».
Enfin, le troisième volet du portrait du spectateur de Hold-up concerne ce qu’on peut appeler les compétences encyclopédiques dont je dispose, c’est-à-dire le type d’imaginaire culturel que j’active pour donner du sens à ce que je vois.
Pour faire bref, cet imaginaire est très français. Je suis Belge, mais en tant que Belge francophone je suis culturellement très proche de la France, je connais son histoire récente, je partage pour une bonne part son paysage mental collectif. Je suis particulièrement marqué par trois éléments de cet imaginaire.
Premièrement, l’opposition entre les élites intellectuelles et médiatiques d’une part, et le peuple d’autre part (cette opposition correspond par ailleurs sur le plan territorial à l’opposition entre Paris et la province). Je sais que la société française est très clivée sociologiquement ; les manifestations des Gilets jaunes ont récemment porté ces clivages à l’avant-plan. Je reconnais que cette société dispose d’un puissant appareil institutionnel de reproduction sociale des élites, notamment via les Hautes Écoles, et d’un puissant appareil médiatique de diffusion de la définition légitime de la légitimité. Le film me tend le miroir de cet imaginaire culturel, en jouant le jeu d’un contre-pouvoir, ou d’une parole « d’en-bas », contre « l’entre-soi » des élites.
Deuxièmement, l’imaginaire français s’associe chez moi à un autre clivage socio-historique important : la mémoire de la Seconde guerre mondiale, la Résistance contre l’occupant nazi et plus généralement contre toutes les formes de totalitarisme. Cette référence historique est explicitement mentionnée dans le film, qui indexe ainsi le rôle de « contre-pouvoir » à la figure, républicaine par excellence, du Résistant.
Enfin troisièmement, l’imaginaire français est encore polarisé par la valeur cardinale de la « liberté » (en particulier dans sa variante « liberté d’expression ») : bien que je puisse personnellement mettre en doute le fétichisme de la « liberté » tel qu’il est brandi à répétition dans les discours médiatiques et politiques, je reconnais ses vertus démocratiques, ici encore par contraste avec les régimes totalitaires qui musèlent leurs citoyens et qui ignorent la liberté de presse. Le film actualise par lui-même ce « droit à la liberté d’expression » en s’énonçant dans l’espace public, mais il convoque aussi en son sein des figures déléguées, que je reconnais comme des emblèmes culturels de cette valeur républicaine : la reprise d’extraits des « Guignols de l’info » me replonge dans mes propres expériences de spectateur jeune adulte qui souriait aux apparitions de « Monsieur Sylvestre » et pouvait se conforter lui-même dans « l’esprit d’impertinence » d’une telle émission. Hold-up m’indique ainsi quelles références culturelles je dois réactiver, avec les valeurs qui y correspondent (« le contre-pouvoir », « la résistance », « la liberté »).
Derrière le label du « citoyen », et en filigrane des « contenus » qu’il énonce, le film adopte des formes qui correspondent, sociologiquement, affectivement, culturellement, à un profil particulier de spectateur.
De quoi le spectateur de Hold-up est-il le nom ?
Ce spectateur-modèle n’est pas construit à partir d’une page blanche : il recycle et réactive des composantes qui préexistent dans les formes de vie des spectateurs du film. Ces formes préexistantes sont pour une part sociales et historiques – c’est bien une certaine trajectoire de vie, un certain rapport à la culture française, une certaine expérience du confinement qui m’ont défini comme spectateur de Hold-up – mais elles sont surtout toujours déjàmédiatiques : aujourd’hui plus que jamais, les formes de vie qui me définissent sont tramées dans des expériences médiatiques. Lorsque je visionne Hold-up, je porte en moi une histoire spectatorielle marquée par une série de formes médiatiques, dont Hold-up se sert dans le miroir qu’il me tend, et qui participent à ma reconnaissance en tant que spectateur de ce film. Or, je ne suis pas un consommateur de films conspirationnistes, je ne fréquente pas les sites consacrés aux théories du complot : ce que je reconnais prioritairement dans Hold-up, ce ne sont pas des « formes déviantes », mais ce sont au contraire des formes médiatiques relativement banales, ou du moins courantes dans les expériences spectatorielles mainstream.
J’ai déjà évoqué le rappel de l’iconographie des films d’épouvante, des séries dystopiques ou des fictions littéraires apocalyptiques, ou la réactivation de la mémoire médiatique des Guignols de l’info ; on peut mentionner aussi les « infographies didactiques » ou les « micro-trottoirs » qu’on trouve dans n’importe quel JT. Mais on peut plus simplement considérer la durée du film Hold-up : 2h43, ce n’est pas une capsule de youtubeur confidentiel, c’est en fait plutôt la durée de trois épisodes de série Netflix, c’est-à-dire le temps d’écran qu’il m’arrive de m’autoriser le soir, en couple, après une journée de travail, ou le week-end.
Une autre forme médiatique prégnante dans Hold-up est la scénographie de l’investigation, abondamment utilisée dans les magazines d’enquête diffusés par les grandes chaînes (type Cash Investigation). Cette scénographie est simple – elle puise en réalité directement aux codes des fictions policières : elle consiste à inscrire une pratique d’enquête dans des formes matérielles (l’ordinateur, la lampe de bureau, la pièce plongée dans l’obscurité), à la faire incarner par un personnage d’enquêteur solitaire, désintéressé, indépendant, porte-parole des valeurs « citoyennes » que nous évoquions tout à l’heure, et à en surdéterminer la visée pragmatique par des variations sur le même geste du « dévoilement » : témoignages exclusifs, vérités qui dérangent, coulisses d’un phénomène, dessous des cartes, immersion sans tabou, face cachée, etc. La scénographie de l’investigation recourt également à ce qu’on peut appeler une heuristique de la « mise en réseau », qui se donne volontiers les codes visuels de la « base de données informatiques » : l’enquête procède par fiches, qui découpent, classent, et recoupent les informations collectées, isolent des « signes particuliers », jusqu’à former une image globale. Bien sûr, tous les épisodes des magazines d’investigation ne sont pas des documentaires complotistes, et c’est précisément souvent dans cette opération de construction d’une image globale que se situe le saut dans la rationalité conspirationniste. Mais les différences (et elles existent) sont, sur le plan formel, moins saillantes que les ressemblances, entre tel magazine d’investigation, et Hold-up, qui en reprend les codes et trouve ainsi tout prêt-à-l’emploi un modèle de spectateur déjà éprouvé par les médias les moins suspects. La clé de voûte du dispositif tient sans doute à une dernière composante centrale de cette forme médiatique qu’est la scénographie de l’investigation : le geste même du « décryptage » critique, procédant au découpage analytique des discours ou des représentations, et dénonçant leur nuisance mystificatrice à partir d’une position extérieure immunisée et sûre de ses normes de vérité. Car en effet Hold-up reprend ce geste à son compte, et le rend bien reconnaissable au spectateur que je suis : car je suis en effet un spectateur-qui-aime-les-décryptages – c’est ce que ne cessent de me répéter les médias que je consomme. Alors comment croire que l’opposition à Hold-up peut encore consister à rejouer ce même geste de décryptage, quand il s’agit précisément de l’un des ingrédients de l’expérience médiatique sur laquelle s’appuie Hold-up pour construire son spectateur-modèle ?