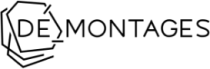Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde qui clôture le cycle de conférences « Que veut (et que peut) encore l’Éducation aux médias aujourd’hui ? », un cycle organisé par Jeremy Hamers, Ingrid Mayeur, François Provenzano et Elise Schürgers dans le cadre du projet de recherche GENEAM, « L’éducation aux médias aujourd’hui. Pour une nouvelle généalogie critique ». Ce projet bénéficie du soutien du Conseil sectoriel de la recherche et de la valorisation en Sciences humaines et de la chaire UNESCO de l’Université de Liège.
Avant de vous présenter les intervenants de ce jour, nous voudrions brièvement revenir à quelques enjeux de ce projet de recherche, ce qui nous permettra également de dire rapidement pourquoi nous avons tenu à clôturer ce cycle par une table ronde qui rassemble exclusivement des acteurs de terrain.
Au départ de notre réflexion se trouve l’identification d’un ensemble de paradigmes fondateurs – ou de « modèles » pour reprendre un terme courant dans la littérature anglo-saxonne exposant un historique de la discipline – de l’Éducation aux médias. Parmi ces paradigmes, il y a celui que nous avons appelé le paradigme émancipatoire qui ancre la discipline dans l’intention suivante : l’Éducation aux médias doit émanciper tout·e citoyen·ne de l’effet des productions et des dispositifs médiatiques pour lui permettre de les utiliser en connaissance de cause et de façon lucide. Concrètement, que ce soit par l’analyse ou la pratique, il s’agirait de permettre à toute personne de s’affranchir de l’effet des médias en prenant conscience des principes, mécanismes et intérêts qui régissent leur fonctionnement. Ce paradigme est à certains égards un héritier du projet émancipateur des Lumières, si ce n’est qu’il ne s’agirait plus désormais de s’affranchir de la croyance à l’aide de la raison, mais plutôt des effets des médias par l’analyse et la pratique. Inscrit dans la discipline depuis ses origines et les approches protectionnistes de la première moitié du 20ème siècle, ce paradigme émancipatoire est aujourd’hui repris massivement par des acteurs, scientifiques ou de terrain, qui tentent par exemple de répondre à la nébuleuse insondable des algorithmes par l’instauration d’une forme de transparence. Enfin, il a aussi produit un ensemble de grands partages qui sont fréquemment rejoués aujourd’hui dans la littérature grise de la discipline : le vrai et le faux, le manipulé et le lucide, l’analphabète et le compétent en litératie médiatique, l’ignorant et l’éclairé.
À l’origine de notre projet, nous avons voulu interroger ce paradigme émancipatoire à nouveaux frais. Parce qu’à un niveau théorique il nous semble que le paradigme émancipatoire est à la fois profondément ancré dans un ensemble d’appareils théoriques qui sont au cœur de nos recherches – notamment la sémiologie critique française et la Théorie critique de l’École de Francfort – mais n’a, par ailleurs, pas complètement pris en charge ce que ces théories ont tenté de dire de la démarche critique elle-même. Pour ne prendre qu’un exemple, la Théorie critique figure certes parmi les premiers appareillages à élaborer une analyse critique des productions médiatiques contemporaines et de leurs effets sur le lecteur et le spectateur. Mais elle est également une des principales théories à avoir douté de la capacité émancipatoire des Lumières. C’est donc d’abord d’un point de vue théorique que nous avons voulu interroger le paradigme émancipatoire de l’Éducation aux médias.
Nous avons eu l’occasion de partager et de nourrir ce point de départ dans le cadre de plusieurs conférences, tables rondes et publications. Si ces réflexions étaient globalement bien reçues et nourries par les retours de collègues, elles suscitaient en revanche quasi systématiquement la même question dans le chef d’acteurs de terrain : « et concrètement, qu’est-ce qu’on fait maintenant ? » Cette question nous a confronté à un double constat : 1/ quand nous disons « recherches », nous ne pensons pas à un travail surplombant qui pourrait livrer des modes d’emploi au terrain ; 2/ nous ne sommes que peu familiers des terrains que pratiquent ces acteurs, parce que notre travail est majoritairement situé dans un cadre universitaire (qui est par ailleurs une des conditions de possibilité premières de notre travail théorique).
Par cette table ronde qui rassemble exclusivement des acteurs de terrain, nous espérons aujourd’hui initier un processus de co-construction de nouveaux savoirs et de nouvelles pratiques, auxquels chacun, à partir de sa position propre, pourra apporter quelque chose. Autrement dit, c’est aussi le partage entre théorie et pratique, recherche et terrain que nous voudrions dépasser ici, tout en gardant à l’esprit que toute action est toujours à penser et à mener sur un terrain spécifique.
En effet, d’une part, les enseignants (et c’est probablement le cas aussi des animateurs) sont des professionnels qui ont été formés à réguler leur pratique, donc à s’autonomiser dans l’ajustement nécessaire à un environnement qui se transforme continuellement. En effet, les médias évoluent, tout comme les pratiques médiatiques des jeunes et des moins jeunes, les conceptions éducatives, etc. ; environnement qui doit aussi intégrer des politiques éducatives, des textes institutionnels ou des programmes qui donnent à voir une certaine conception de l’éducation aux médias. Ces acteurs sont donc formés à réfléchir et à faire évoluer leur identité professionnelle tout comme leurs pratiques, le choix des ressources, des concepts, etc. D’autre part, il faut peut-être revenir sur une ligne de partage pré-établie et souligner d’emblée que nous sommes, nous aussi, des acteurs de terrain, avec un terrain spécifique qui est l’université. Par le métier qui est le nôtre, nous avons eu (dans une large mesure durant les années de thèse) — et avons encore — l’occasion de lire de plus près certains textes qui ont nourri l’appareil conceptuel de l’éducation aux médias, d’y réfléchir en les mettant au travail, d’identifier des limites, des contradictions, des ouvertures, etc. Ceci facilite la mise en perspective théorique d’une approche généalogique de l’éducation aux médias, à travers laquelle on voit bien toutes les limites des lignes de partage qui tendent à se consolider actuellement, dans les textes politiques et institutionnels surtout, en particulier autour des enjeux liés à la désinformation (d’où : le vrai/le faux, le transparent/l’obscur, la lucidité critique/la passivité, etc.).
Alors qu’est-ce qu’on en fait, dès lors que nous sommes engagés dans la formation d’étudiants à des disciplines qui touchent de près ou de loin à l’éducation aux médias, ou, en tout état de cause, que notre métier est de les former à acquérir un regard critique (qu’on peut prendre ici au sens étymologique de krinein qu’avait rappelé Yves Jeanneret dans Critique de la trivialité (2014, 695), discerner, juger, décider ; tout en posant que la critique, c’est lié à l’émancipation et c’est en soi un objet de questionnement quant aux finalités à développer) ? A fortiori, comment conçoit-on notre action en étant investis d’un rôle social où l’on attend de nous (ce qui est logique, vu qu’on dispose de cette possibilité matérielle de réfléchir plus théoriquement) que nous puissions proposer des ressources, un regard spécifique sur ces questions ?
Donc, nous sommes également des acteurs sur un terrain au sein duquel ces tensions émergent, où l’on doit se positionner entre liberté académique, politique scientifique, contraintes institutionnelles, responsabilité sociétale ; tensions qu’il nous faut résoudre (de manière un peu schizophrénique parfois, il faut bien l’admettre). Pour ne donner qu’un exemple, comment outiller nos étudiants pour qu’ils puissent eux-mêmes se positionner dans leur futur métier, comment s’y prendre dans un cadre de compétence qui est souvent orienté vers le développement de compétences instrumentales et d’une vérification parfois assistée algorithmiquement des sources d’information ?
Bref, pour nous, cette position aussi reste à construire.