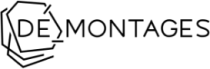Chaque personne engagée dans une recherche doctorale vit à sa manière l’exercice qui consiste à expliquer son sujet de thèse, autour d’une table ou un verre à la main, et en l’espace de quelques phrases qui se doivent d’être à la fois…fines, mais synthétiques, percutantes mais pas racoleuses, déjà profondes !, mais sans ésotérisme. Le virement ultracontemporain que la thématique de ma thèse représentait par rapport au sujet qui m’avait jusque-là occupée[1] m’offrait généralement, au cours dudit exercice, un luxe, nouveau pour moi, celui d’un intérêt presque d’emblée acquis une fois le mot-clé lâché : « fake news ». Le problème est actuel, important, ou, au moins, il évoquait toujours quelque chose pour chacun.
Seulement voilà, le luxe d’une attention si facilement gagnée se mâtinait rapidement d’un certain inconfort. La conversation progressant, j’observais généralement chez mon interlocuteur/interlocutrice que l’intérêt initialement suscité se muait en froncements de sourcils, parfois en incompréhension agacée, ou simplement en une suite de quiproquos, dès lors qu’aux questions (tu aboutis à quoi comme définition pour « fake news » ? comment explique-t-on que les gens y croient ? et quelles sont les solutions qui existent ou que tu proposes ?), il me fallait inlassablement répondre, et risquer de rompre avec cette curiosité peut-être illégitimement éveillée, que là n’était pas vraiment mon objet, que, en toute honnêteté, ce qui m’intéressait n’était pas les fake news elles-mêmes, mais les discours tenus à leur propos ; pas tant les actualisations contemporaines de la désinformation, les intentions dans lesquelles elle s’origine, les stratégies qui lui donnent forme ou encore les modalités de sa diffusion, mais bien la manière dont ces questions étaient devenues un objet de discussion dans l’espace public, la façon dont ces différents dossiers y étaient parlés – au point qu’ils soient, justement, à même de provoquer ce type de réaction dans la conversation en cours.
///
Je voudrais profiter du temps qui m’est accordé aujourd’hui pour expliciter, en premier lieu, quelques-uns des motifs qui m’ont conduite à investir ce volet du discours sur. Trois d’entre eux me semblent significatifs.
1/
Le premier n’est pas étranger à la source de mon propre inconfort, parfois éprouvé au cours des discussions que je viens d’évoquer, lequel tenait à mon refus de participer à la reconduction de cet entre-soi implicite, celui de ceux qui savent qu’ils ne sont pas dupes, que le problème des fake news choisit ses victimes en dehors des participants à notre échange, ces dernières étant celles dont la nécessaire naïveté demanderait avant tout à être éclairée d’un rapport plus rationnel aux discours en circulation.
Ce sentiment fait notamment écho aux mots des sociologue et philosophe Albert Ogien et Sandra Laugier, dont vous entendrez qu’ils sont habités par une irritation palpable face aux récurrents commentaires formulés au sujet de nos sociétés démocratiques, à la période qui, pour faire vite, suit les élections américaines de 2016 ou le référendum lié au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne. Je les cite :
Les sociétés démocratiques auraient dépassé le stade de la démagogie pour entrer dans l’ère du « postfactuel » ou de la « postvérité » – un néologisme inventé pour nommer des « [définition donnée par l’Oxford Dictionary en 2015] circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d’influence pour modeler l’opinion publique que les appels à l’émotion et aux opinions personnelles ». La notion de postvérité est alors arborée fièrement par tous ceux et celles qui se croient une élite, seule capable de discerner et de dire le vrai, contre la masse des faibles d’esprit et ignorants qui se laissent quotidiennement berner par la force du verbe et des mensonges[1].
L’horizon de mon travail n’était pas d’absolument parvenir à se prononcer en faveur de l’une ou l’autre forme de discours de dénonciation, que j’ai artificiellement binarisés ici – dénonciation des mensonges éhontés et volonté de rapidement s’armer contre le fléau, ou (méta)dénonciation d’un certain discours formulé sur l’état des démocraties, au motif qu’il se contente de déclarer les incapacités présumées d’un certain public. Cela étant, la remarque des deux auteurs laisse clairement entendre une part des enjeux critiques qu’un travail de collecte, de documentation et d’analyse des discours sur les fake news peut s’attacher à questionner.
2/
Ces propos font par ailleurs état ou écho à une sorte de scène de destitution (c’est le rôle du préfixe, dans postvérité et postfactuel). Or, on n’accède jamais autant aux modes opératoires, aux systèmes de normes, aux autoreprésentations agissantes qui organisent le fonctionnement des institutions qu’au moment de leur crise. Et c’est là une deuxième motivation au déplacement de perspective adopté par la thèse. Ce déplacement rejoint l’angle d’approche auquel invitent par exemple deux chercheurs danois, Johann Farkas et Jannick Schou, ceux‑ci proposant que, au lieu de supposer (comme cela est inféré par la proclamation d’une « ère de la post-vérité » bouleversant les assises démocratiques) que tous les régimes de vérité institués fonctionnaient et fonctionnent sans heurts pour le bien de l’ensemble du corps social, il est possible de faire du débat sur les fake news un prisme au travers duquel interroger le fonctionnement interne de ces régimes de vérité[1].
Cet angle d’approche général a pour corollaire un parti pris. Celui-ci pose, en substance, que ce sont également les discours tenus sur l’objet qui font cet objet ; autrement dit, que l’importance du problème des fake news réside peut-être fondamentalement aussi dans les manières que nous avons d’y faire référence, c’est-à-dire dans le sens qui lui est conféré, dans les découpages de la réalité sociale que ces discours qui disent « fake news » participent à produire et donc dans la façon dont ceux-ci orientent le débat public autour de problèmes donnés (pour, inévitablement, en marginaliser d’autres), dans la place qu’ils laissent ou non à une prise réflexive sur les enjeux et les dynamiques de l’action publique que le phénomène soulève ou encore, comme déjà mentionné, dans l’image produite des publics et de leurs rapports aux pratiques informationnelles.
3/
Le troisième point d’interpellation est celui qui m’a fourni une prise et une clé d’entrée dans ce terrain d’analyse. Cette interpellation touche au mot lui-même, à ce néologisme par emprunt à l’anglais qu’est la locution « fake news », à l’hypervisibilité qu’elle s’est arrogée au tournant de l’année 2017 et, surtout, aux commentaires qui ont été formulés à son sujet.
L’Académie française lui consacrait par exemple une notice dans sa célèbre rubrique « Dire, Ne pas dire ». Voici ce que l’on y lit :
Depuis plusieurs mois l’expression fake news s’est largement répandue en France. Celle-ci nous vient des États-Unis et nombre de commentateurs et de journalistes semblent avoir des difficultés pour lui trouver un équivalent français. Pourtant, ne serait-il pas possible d’user de termes comme bobard, boniment, contre-vérité, mensonge, ragot, tromperie, trucage[1] ?
Par l’apparente simplicité de sa question (« ne serait-il pas possible de […] ? »), la notice, véritable cas d’école, évince la possibilité de problématiser le phénomène néologique : elle en suggère l’inutilité et semble manquer que la locution n’est pas simplement ou seulement un nouveau mot à la mode pour qualifier des phénomènes existant depuis des siècles. Le succès d’un tel anglicisme, sa centralité par rapport à ses alternatives (fausses nouvelles, intox, infox, etc.) montrent qu’elle vient moduler une réalité particulière en l’investissant d’enjeux, d’habitudes interprétatives, de réflexes communicationnels qui ne sont pas forcément nouveaux mais qui sont portés à la surface du débat public et détiennent une force d’interpellation toute conjoncturelle. Le linguiste Jean-François Sablayrolles écrivait en ce sens : « les néologismes nomment souvent moins une réalité radicalement nouvelle qu’une nouvelle manière de les appréhender[1] ».
Si un pan de la recherche enjoignait donc à considérer « fake news » comme un mot passe‑partout, un ballon baudruche qu’il fallait s’efforcer de percer, j’ai pour ma part écarté l’idée que ce ballon enfermait du vide, et préféré chercher à comprendre ce qui le maintenait en l’air.
Le levier de problématisation de ma recherche est donc d’abord lexical : il s’agit de prendre la mesure du poids du mot, inséparable de l’histoire que lui confère son usage au sein d’un espace sociopolitique donné. L’objectif général a donc été de cartographier les coordonnées de la mise en discours de l’anglicisme et de ses multiples reprises, et ce afin de prendre au sérieux la manière dont les formes de sa circulation travaillent les enjeux auxquels je faisais allusion plus tôt. Comment se sert-on de « fake news » ? c’est-à-dire, de quelles injonctions, de quels effets de légitimation et de disqualification la locution est-elle l’instrument ? de quelles orientations argumentatives serait-elle le noyau ? et finalement, que permet-elle de rendre visible et problématique et que participe-t-elle au contraire à rendre acceptable ?
///
J’en viens à la manière dont j’ai déplié ce programme de recherche.
Dans un premier temps, il m’a semblé indispensable de caractériser la locution en regard de son statut de néologisme par emprunt. J’ai ainsi consacré un chapitre à identifier les mécanismes sociolinguistiques ayant accompagné l’introduction de « fake news » dans le discours francophone – tel qu’il peut se saisir par le biais de mon corpus médiatique, celui-ci rassemblant une part de la production de la presse écrite quotidienne généraliste en France et en Belgique francophone.
Avant d’être cette expression dont on se passe aujourd’hui difficilement à l’abord de plusieurs thématiques et d’une actualité qui reste pour le moins difficile, avant d’être devenue cet interprétant commun, dont on sait qu’il sera reconnu et retiendra l’attention, le néologisme s’est trouvé à cheval entre les innovations de l’usage et leur intégration dans un système communicationnel partagé. J’ai donc commencé par identifier les voies empruntées par l’expression pour s’intégrer à un univers avant tout linguistique, mais aussi culturel, médiatique et politique francophone, de mesurer les adaptations – sémantiques, morphosyntaxiques – que le locuteur francophone avait apportées à l’expression anglophone pour se l’approprier.
Il y a en effet une courte période, d’environ trois mois, qui précède le moment lors duquel le mot prend, avant qu’il ne connaisse sa phase de forte médiatisation. Ces premiers emplois fleurtent alors encore avec son acception initiale, selon laquelle « fake news » renvoyait à des pratiques de parodie et de satire de l’information d’actualité. On pourra y relever des usages qui ne seraient plus lus aujourd’hui de la même manière. Ainsi, un article intitulé « Le vrai du fake » évoquerait plus tard un article de vérification des faits, de fact-checking (au sens de « démêler le vrai du faux »), là où, en décembre 2016, aux premiers temps de la circulation de l’anglicisme, l’énoncé attesté (« Le vrai du fake ») renvoie en réalité à l’idée que l’on puisse trouver du vrai dans le faux, que l’on puisse chercher des vérités au sein de certaines pratiques du faux, du canular, du mensonge.
Au sortir de ces analyses, il s’est ainsi avéré possible d’identifier, dans les manières de dire la locution, une série de points d’inflexion débouchant sur la période au cours de laquelle « fake news » connaît un fonctionnement discursif qui fait alors d’elle une formule. La notion de formule – telle qu’elle a été théorisée par Alice Krieg-Planque (à la suite, principalement, des travaux de Jean-Pierre Faye et de Marianne Ebel et Pierre Fiala, et à partir de son travail sur les emplois de la séquence « purification ethnique » dans le cadre du récit médiatique des guerres yougoslave) – a été centrale dans la façon dont j’ai construit la suite de ma recherche. La notion permet en effet de saisir et de caractériser ce moment lors duquel une séquence lexicale se fige dans une forme spécifique (on pourra exemplairement penser à « développement durable » ou « gilets jaunes ») ; ces séquences lexicales se mettent à fonctionner comme des expressions conjointement partagées et problématiques, comme des mots à la fois utilisés par une diversité de locuteurs, tout en étant investis de parcours de sens conflictuels.
Une telle caractérisation autorise à sortir, partiellement, du réflexe auquel semble contraindre la polysémie du mot, à savoir s’efforcer d’attribuer à tel locuteur tels sens et usage stratégique de l’anglicisme. Ces découpages, souvent déjà bien identifiés, rendent compte – schématiquement – du fait que certaines figures politiques emploient « fake news » comme une étiquette pour attaquer et délégitimer les médias traditionnels, par d’autres pour caractériser un nouveau genre de contenu en circulation sur Internet, par d’autres encore comme un mot facile et accrocheur pour capter l’attention et jeter le discrédit sur une parole ou un point de vue. Tout en prenant acte de ces découpages, mon ambition a été de considérer leur espace d’interaction, leur cointelligibilité et les effets possibles de leurs influences mutuelles au sein du discours journalistique. C’est en effet bien les rapports de déterminations réciproques de ces discours qui ont érigé la question des fake news en problème public, et plus spécifiquement, en enjeu démocratique et citoyen, résonnant avec ce que l’on nomme communément une « crise de l’autorité ».
Là résidait le second temps de mon analyse, visant à répondre à la question générale suivante : quelles sont les manières de dire « fake news » qui ont mené à ce que le phénomène soit institué en préoccupation collective ? Autrement dit, comment, au-delà des contenus, ce sont bien les formes langagières qui s’agrègent à la formule « fake news » et en stabilisent le sens, qui peuvent être analysées comme des traces et des moyens d’élaboration d’un ensemble d’imaginaires communicationnels et politiques construisant le sens social du phénomène.
Sans entrer dans le détail, la thèse s’est ainsi intéressée à une gamme de ressources langagières exploitées par les locuteurs pour dire la formule et l’inscrire dans leurs manières de faire sens et communauté autour de la question. De façon illustrative, je pointerais aujourd’hui rapidement, au sein de ces ressources langagières, trois points d’attention exemplaires :
- Il y a d’abord le niveau des solidarités formelles les plus directes de la formule, qui en creusent le sillon interprétatif. En se préoccupant des mots qui lui tiennent le plus directement compagnie (c’est-à-dire des phénomènes de co-occurrences, des phraséologies, des structures ou segments répétés dans lesquels la locution s’insère), on peut par exemple se rendre compte à quel point les fake news sont perçues comme un phénomène doté d’une agentivité auto-amplifiante (elles se propagent, se diffusent ou prolifèrent) ou encore qu’elles ont acquis une valeur métonymique grâce aux si nombreuses séquences du type « à l’ère ou à l’heure des fake news/dans un monde inondé de fake news/en ces temps de fake news », séquences dans lesquelles la formule sert à fonder un nouveau paradigme de catégorisations spatio-temporelles – elles y deviennent la cause ou le symbole d’un tournant dans nos rapports collectifs à la circulation de l’information et à la parole publique.
- Je me suis ensuite intéressée aux ressources figurales que mobilisent les locuteurs pour appréhender ce phénomène abstrait, pour l’ancrer dans une imagerie concrète et partageable, tout en suggérant une vision et un positionnement spécifiques quant à la réalité désignée. La métaphore de la viralité (il est régulièrement question d’une épidémie de fake news) est ainsi indissociable du processus d’installation de la formule dans le langage courant. Elle renforce par ailleurs le présupposé selon lequel l’exposition à un objet médiatique impliquerait forcément la passive perméabilité du sujet qui le reçoit, de la même manière qu’elle (la métaphore) soustrait ces messages médiatiques (les fake news) aux mécanismes délibératifs et interprétatifs propres aux situations de communication qui en influencent pourtant la circulation.
- Enfin, un autre volet de la recherche a par ailleurs été consacré à la manière dont ce n’est pas seulement la réalité à laquelle la formule renvoie qui fait polémique, mais bien le mot lui-même. L’examen des discours sur le signe linguistique « fake news » – sur son adéquation aux référents qu’il prétend saisir ou sur son instrumentalisation – a permis d’observer selon quelles modalités les locuteurs eux-mêmes traduisent les enjeux qu’il y a à nommer le réel.
///
Finalement, cette attention empirique, appliquée à progressivement mettre au jour les matérialités discursives qui participent aux processus de qualification (au sens que lui donne Érik Neveu)[1] des « fake news », a, je l’espère, œuvré à rayer un peu ce disque qui ne cesse de chanter que, ce que soulève la formule, c’est uniquement un débat sur la vérification et la régulation de l’information ; que le défi posé à la démocratie relève, simplement et avant tout, de la nécessité d’améliorer la compétence des citoyens à distinguer le vrai du faux – alors que la manière dont se construit cet enjeu même est le fruit de négociations, de rapports de forces et d’opinions.
Je terminerai donc par dire que ce parcours me semble avoir fourni quelques prises pour comprendre le pouvoir agissant de la formule, c’est-à-dire la manière dont celle-ci a des incidences potentielles en dehors de l’univers strict de la parole. On ignore en effet difficilement l’opérativité symbolique dont le mot s’est doté, et les appropriations institutionnelles que cette opérativité encourage. La formule réquisitionne d’abord bien sûr le secteur journalistique, qui en fait un moyen de créer les conditions pour une énonciation autolégitimante, et tend par ailleurs à infléchir çà et là ses pratiques et formats, multipliant les articles et rubriques de fact-checking. Mais la question des « fake news » fait aussi l’objet d’une série d’initiatives législatives, tout comme elle oriente une pluralité de politiques éducatives ou culturelles, dont les pratiques et missions sont alors instituées en, et parfois réduites à des outils d’identification des lieux où s’exercent les paroles jugées légitimes. In fine – et je ne fais ici que réouvrir le questionnement –, cette opérativité me semble fonctionner sur un registre qui participe à une forme de dépolitisation du débat public, tantôt en naturalisant, dans une rhétorique du « fait brut », des phénomènes qui sont en réalité socialement et politiquement construits, tantôt en réduisant le principe démocratique aux institutions dans lesquelles il est censé s’incarner (les « fake news » seraient un danger pour la démocratie avant tout parce qu’elles compromettent les processus électoraux), tantôt en confinant les mécanismes interprétatifs à un seul type de rapport pragmatique à l’information, celui d’être éclairé par les faits.
[1] Erik Neveu, Sociologie politique des problèmes publics, Paris, Armand Colin, 2015.
[1] Jean-François Sablayrolles, Comprendre la néologie. Conceptions, analyses, emplois, op. cit., p. 198.
[1] « Fake news », Académie française, 2017.
[1] Johan Farkas, Jannick Schou, Post-Truth, Fake News and Democracy. Mapping the politics of Falsehood, Second Edition, New York, Routledge, 2024.
[1] Sandra Laugier, Albert Ogien, Antidémocratie, Paris, La Découverte, 2017, p. 13.
[1] À savoir les effets de lecture issus d’une série de mises en texte de l’hétérogénéité énonciative dans les romans de Gustave Flaubert.